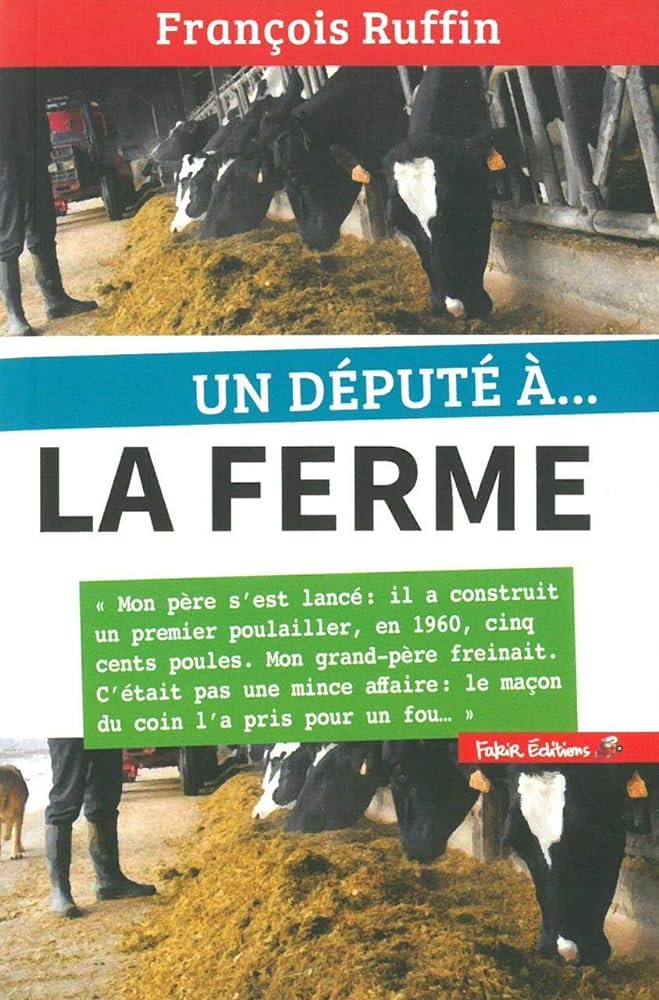"J’ai senti la mort dans mon ventre"
par 14/01/2020 paru dans le Fakir n°(90) Date de parution :

On a besoin de vous
Le journal fakir est un journal papier, en vente dans tous les bons kiosques près de chez vous. Il ne peut réaliser des reportages que parce qu’il est acheté ou parce qu’on y est abonné !
Marion a perdu sa petite. Et de sa douleur, elle tire une leçon politique.
Marion discutait avec François, après une projection de J’veux du soleil !, près de Pau, et dans le brouhaha, je n’entendais pas très bien. Je chopais juste quelques bribes : « Mon bébé... perdu... hôpital… », une horreur en filigrane, qui contrastait
avec son sourire, sincère, de jeune femme épanouie. Je me suis rapproché : « J’ai perdu un bébé, oui, le 20 décembre. Enfin, ‘‘perdu’’… J’aime pas cette expression, ‘‘perdre’’, c’est de l’euphémisme, pour ne pas choquer la société. Il ne faut pas dire ‘‘mort’’, mais c’est le mot, en fait. »
Marion est prof de philo, la trentaine, « privilégiée, dans le système », de bons médecins pour la suivre. Et puis, « on s’est séparés pendant ma grossesse, avec le papa. Alors, je suis entrée dans une démarche pour être forte, capable de me débrouiller toute seule ». Ronde, dans les dernières semaines, elle manifeste même avec les Gilets jaunes. « Ce mouvement, pour moi, il a le goût de ma grossesse. » Tout se passe bien, jusqu’aux derniers jours. Mal au ventre, un soir. « J’ai appelé la sage‑femme à la maternité qui m’a dit : ‘‘Prenez un spasfon, détendez‑vous, et venez si ça ne va pas mieux. ’’ Alors, je me le redis : je dois me débrouiller seule. Pourtant, j’étais suivie comme une grossesse à risque. J’avais choisi l’hôpital public par conviction, je pensais que ce serait le mieux pour accoucher. Mais, durant mon suivi, les obstétriciens faisaient des rendez‑vous au quart d’heure, une sage‑femme m’a dit qu’ils avaient fait vingt‑deux naissances en 48 heures… Ils sont débordés. Les maternités d’Oloron et Orthez ont fermé. Dans le Béarn, du coup, il ne reste que celle de Pau, où j’ai accouché. Une maternité de niveau 3 mais qui est engorgée par les cas les plus simples. » Alors, ce soir‑là, Marion attend, transige avec la douleur.
« En fait, mon bébé, ma petite fille, était en train de mourir.
Dans la nuit, j’ai fait une hémorragie. J’ai su, sur le moment : j’ai senti la mort dans mon ventre. On est connecté à ce corps du bébé, à ses sensations. Je l’ai senti lâcher. Quand j’ai vu tout ce sang, j’ai su que c’était fini. J’ai appelé le 15, je me suis retrouvée à l’hôpital. La sage‑femme que j’avais eue au téléphone était là. ‘‘C’est vous, la dame que j’ai eue au téléphone ?’’, elle m’a demandé. J’ai exprimé de la colère, pendant deux secondes, peut‑être : ‘‘Vous auriez dû me dire de venir !’’ Mais j’ai vu son visage, et toute l’humanité de son expression, j’ai vu qu’elle était désolée, c’était un drame pour elle aussi. J’ai vu les sages‑femmes et les obstétriciennes pleurer avec moi. C’est pour ça, aussi, que toute cette histoire est politique : c’est partagé. »
Marion s’en sort elle‑même de peu.
« Si je n’avais pas habité aussi près de l’hôpital, je serais morte, moi aussi. Le bloc pour la césarienne était déjà prêt, car ils allaient en faire une autre en urgence, mais ils m’ont fait passer avant elle. Vous voyez, l’état d’engorgement ? C’est un truc de dingues. Comment un pays riche comme la France peut‑il économiser là‑dessus ? Pour des femmes, en obstétrique ? J’ai l’impression que ce sont toujours les services où les femmes sont concernées qui ferment en premier. »
La suite se déroule comme dans du coton, autopsie, analyse du placenta, du cordon ombilical, tout petit cercueil, la prise en charge, « choyée », pendant cinq jours, mais pas un de plus.
« Les résultats de l’autopsie ne venaient pas. Le plus dur, au début, c’est la culpabilité : moi je suis là, et pas elle. Mon corps a abandonné mon bébé, je l’ai laissé tomber. J’avais besoin de comprendre. Et puis, un événement comme ça, ça fait comme une goutte qui tombe dans l’eau, des cercles qui touchent les gens autour de vous. Ma maman ne s’en est pas remise. Une amie proche s’est effondrée psychologiquement. »
« On vous rappellera, on vous rappellera », rengaine l’hôpital. Marion s’enfonce. Jusqu’à ce qu’elle tente un coup de force à l’hosto, insiste, menace de squatter les lieux. Le dossier était tombé dans le mauvais bac, perdu, personne n’avait eu le temps de regarder tout ça, d’y jeter un oeil, toujours dans l’urgence. Marion lit enfin les pages, les mains tremblantes. « Il y avait un problème avec le cordon. Il pouvait produire des hémorragies. Ce n’était pas ma faute : la nature avait foiré. Mais on aurait pu le relever bien en amont... Je n’en veux pas du tout aux médecins. C’est une défaillance du système. Pour l’obstétricienne, c’est un drame, aussi, de perdre un bébé qu’elle suivait. J’en veux pas à des personnes : l’hôpital, comme l’école, je le vois, on fonctionne sur la brèche. Il y a une perversité du système qui met les gens dans la difficulté matérielle. Des gens qui se dévouent, et à qui on dit après ‘‘Vous voyez, vous n’y arrivez pas…’’ Avec moi, il y a eu un foirage du début à la fin. Avant, parce qu’ils font des échographies à la chaîne et n’ont rien vu. Pendant, parce qu’on me dit de me débrouiller seule, mais dans une situation normale, on reçoit toutes les mamans. Et puis, après coup, ‘‘un problème de gestion’’. En fait, la société se décharge sur les individus. Mais les responsabilités, elles ne doivent pas peser sur ceux qui ont les mains dans le cambouis. »
Marion est retournée à l’hosto, plusieurs fois, depuis. « J’ai vu des gens débordés, la souffrance partagée autant par les patients que par les soignants. Des gens, là‑haut, dans les bureaux, gèrent des choses derrière un ordinateur mais ils ne voient pas les souffrances humaines que cela représente. Alors, je vais aller à l’ARS, quand même, dans l’institution, pour les voir, pour que les gens qui font de la gestion voient qu’il y a des visages derrière leurs décisions. »
Elle ne s’est pas effondrée, Marion, mais elle tangue, sérieusement. « Ce n’est pas juste un traumatisme d’un jour. Cette petite fille, elle me manquera toujours. » Elle l’a appelée Sarah.