N’ayons plus peur !
par 20/03/2018 paru dans le Fakir n°(83) Date de parution : novembre décembre 2017

On a besoin de vous
Le journal fakir est un journal papier, en vente dans tous les bons kiosques près de chez vous. Il ne peut réaliser des reportages que parce qu’il est acheté ou parce qu’on y est abonné !
La France a peur.
Une peur qui ronge les coeurs.
Une peur qui rétrécit les esprits.
Une peur qui enlaidit le pays.
Alors, à quoi je sers comme député ?
À délivrer ma parole pour libérer la vôtre, je crois.
Tel est mon rôle, ma petite utilité, ma pierre à l’édifice.
Et qu’on gagne ensemble en assurance...
Je crève
Parlez- moi !
Parlez- moi !
Si vous trouviez
les mots dont j’ai besoin
Vous me délivreriez
De ce qui m’étouffe. »
Charles Juliet,Lambeaux.
« [*Vous parlez des Whirlpool*], des Goodyear, des Parisot, des Abélia, mais pourquoi vous ne parlez pas de nous ? »
C’est Claude et Patrice, des quinquas, au téléphone, qui nous ont reproché ça. Alors, on a pris rendez-vous avec eux : qu’est-ce qu’ils voulaient nous raconter ?
« On était chauffeurs chez Mory-Ducros, de 1980, tous les deux, jusqu’à la fermeture, en 2014. Ils ont supprimé l’agence d’Amiens, elle se trouvait à la Zone, y avait quand même 75 personnes qui desservaient le département. En France, on était 5000.
—Ils ont tout liquidé d’un coup ?
— Non, ils ont commencé par la moitié, en 2014. Mais ils ont prévenu : ‘‘Si vous manifestez, si vous faites grève, on licencie les 5000.’’ En plus que monsieur Montebourg, celui-là on le retient, il nous a servi la même leçon, de ‘‘sagesse’’, de ‘‘responsabilité’’, qu’il ne fallait pas nuire au reste de l’entreprise. C’est pour ça qu’il n’y a pas eu de mouvement important. Le mot d’ordre, c’était : ‘‘Restez chez vous !’’
—Mais ça n’a pas sauvé la boîte ?
— Non. L’année d’après, ils balançaient tout.
La deuxième moitié. Tout ça, c’était un truc de l’actionnaire, Arcole.
— Et vous le regrettez, qu’il n’y ait pas eu de
mouvement ?
— Bah oui. Déjà, on aurait peut-être touché plus d’extra-légale, là ils nous ont donné 15 000 €, au bout de 34 années de boutique. Surtout, on a perdu nos
droits à la retraite. Parce que, normalement, dans le transport, comme c’est pénible, on a le droit de partir à 57 ans, c’est le CFA, le Contrat de Fin d’Activité. Mais là, comme on a changé de branche, comme ça s’est fait sous la pression de l’État, rapide rapide rapide, les syndicats n’ont pas négocié ça. Ils auraient pu.
— C’est comme une double peine, alors ? Non seulement vous êtes virés, mais vous prenez une rallonge pour la retraite ?
— Voilà.
— En revanche, excusez-moi, mais c’est normal qu’on ne parle pas de vous, vous ne pouvez pas nous le reprocher : si les salariés eux-mêmes ne se bougent pas, c’est pas nous qui allons le faire à votre place ! »
Claude et Patrice opinaient.
« Y a pas eu un jour de grève ?
— Non.
— Un feu de palette ?
— Non. ‘‘Faut pas, faut pas…’’, nous disaient même nos délégués. On nous a jetés, même pour l’honneur on n’a pas réagi…
— C’est comme si vous aviez consenti à votre propre
meurtre ?
— Voilà.
— Comme si vous en étiez les complices… Mais maintenant, vous accepteriez qu’on tourne une petite vidéo ?
— Ça serait compliqué…
— Ou de grimper sur une estrade pour raconter ça ?
— C’est difficile, on a retrouvé un employeur, en CDD…
— Vous faites quoi ?
— De la logistique. On aurait pu retrouver dans le transport, peut-être, mais le secteur est devenu fou. Ils nous demandent des 12 heures par jour, des 60 heures par semaine, avec la concurrence de l’Est. Je bossais chez Valeo, dans les entrepôts, je voyais les express polonais, roumains, qui chargeaient, qui déchargeaient… À 55 ans, on n’a pas envie de replonger là-dedans, on ne sera plus ‘‘compétitifs’’. On a fait de l’intérim, là on est en CDD, plus ou moins fixés dans des boîtes… »
J’en ai marre.
Je rencontre une dame qui travaille au RSI, le truc des artisans, qui me livre des documents et tout, mais qui ne veut pas témoigner parce que ceci cela. Idem dans une chaîne de supermarchés, faut pas livrer le nom de l’enseigne, ni des caissières. Idem pour un gars, dans une usine que vous ne saurez pas laquelle. Idem, encore, au Secours populaire, la double peine de la misère, la misère et la honte de la misère. C’est tout un monde souterrain qui ne veut pas, qui n’ose pas se dire, motus et bouche cousue, c’est toute une France invisible et qui se rend invisible.
Règne de la peur, peur du chômage, de la sanction, peur aussi du regard des autres, la peur et les mille lâchetés qu’elle entraîne.
[*Ça fera six mois, bientôt*], que je siège à l’Assemblée. Et pour mon bilan d’étape, je voudrais passer tout le négatif.
Oui, souvent, je me sens enfermé.
Oui, leur langue, molle, creuse, me fatigue le cerveau.
Oui, je culpabilise, aussi, de manquer des rendez- vous.
Etc.
Mes états d’âme, je pourrais en tartiner des pages.
Je préfère, ici, vous dire ma petite, ma modeste utilité.
Dans ma profession de foi, ce printemps, adressée à tous les électeurs, j’écrivais ça :
Demain, comme député, je ne vous promets pas la lune, que grâce à moi tout sera merveilleux, du walt Disney. En revanche, je m’engage à ça : devant les ministres, devant les PDG, je ne me dégonflerai pas. Je ne courberai pas l’échine. Je ne serai le petit soldat ni d’un gouvernement, ni d’un parti. Je ferai entendre votre voix, celle des ouvriers, des enseignants, des caissières, des aides-soignants, des téléconseillers, des restaurateurs, des camionneurs, des mères célibataires, des animateurs, des vacataires, des handicapés, de leurs parents, des agents d’entretien, des auxiliaires de vie, des multi-précaires, face aux administrations, face à la rigueur budgétaire, face aux multinationales, face à la Commission européenne, face aux actionnaires, etc. Bref, je serai avec les « petits » (et les « moyens ») contre les « gros ». Avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, qui aspirent à une planète vivable, respirable pour tous, contre les intérêts égoïstes, aveugles, suicidaires des puissances de l’argent.
Cet effort, je le fais depuis longtemps maintenant,
dans la somme et ailleurs.
Je le poursuivrai, quoi qu’il arrive, même si vous ne me portez pas à l’Assemblée.
Mais si vous m’accordez l’écharpe tricolore, ma voix sera alors forte de vos milliers de voix. Pour les secouer, ma légitimité sera renforcée. Devant eux, grâce à vous, je tremblerai moins. Je serai fier de vous représenter.
C’était ma seule promesse, mon unique engagement : d’attitude, on pourrait dire.
Cette parole, je l’ai tenue, je crois.
Même si je tremble.
Moins, mais je tremble.
Toujours, à l’Assemblée, montant au micro, je tremble.
Ma voix chevrote.
À cause de quoi ?
Une illégitimité, encore, toujours, à être là, « petit » face aux « grands », pas à ma place.
Comme si j’avançais sur une corde raide, aussi, entre le formidable et le ridicule, sans filet, avec la peur de chuter, et d’être aussitôt piétiné.
La politesse, également, qu’on m’a enseignée, une docilité, la violence qu’il faut se faire, à soi, à son éducation, pour casser leurs codes de bonne conduite, non je n’attendrai pas mon tour, non je ne vous livrerai pas à l’avance ma question, non je n’emploierai pas à mon tour votre langue molle et creuse, anesthésiante.
***
C’est une idée qui me traverse, je vais mal l’énoncer, avec des à-peu-près : on se sent d’une classe inférieure, d’une caste, presque d’une race inférieure.
Quand on regarde Emmanuel Macron à la télé, au hasard, mais ça pourrait être François Fillon pareil, ou Bernard Arnault, quand on les écoute, dans leurs phrases, dans leurs corps, dans leurs intonations, dans leur gestuelle, on
lit ça : que le pouvoir leur est naturel, que la domination leur est acquise, une autorité qui va de soi, comme si les rênes du monde étaient entre leurs mains depuis le fond des temps et pour l’éternité. Et nous, à côté, moi en tout cas,
j’éprouve une infériorité. Il nous manque un truc. Causer comme eux, avec leur voix posée, sûre d’elle, leur ton calme et qui nous gronde pourtant, avec des silences au milieu, on n’y arrive pas, une assurance qui fait défaut.
On le dit, on le répète :
« Les hommes naissent libres et égaux en droits. Mais dans les faits et les fortunes, non. »
Sauf qu’il y a pire, je crains : dans nos propres têtes, nous ne sommes pas leurs égaux.
[*Alors, je viens chercher quoi*], à l’Assemblée ?
Et j’espère vous ramener quoi, par contagion ?
De l’assurance.
Que, à me voir apostropher ministres et PDG, ça vous contamine. Que vous trembliez moins devant votre hiérarchie, ou plutôt que, malgré le tremblement, vous défendiez votre collègue, que vous parliez en égaux à votre chef, ou à votre maire, ou au président de je ne sais pas quoi.
En égaux, rien de plus.
Déjà, c’est fait, on a dupé Bernard Arnault, on l’a cinématographiquement ridiculisé, ça le ramène sur terre, parmi nous.
D’ailleurs, c’est lors d’un entretien en tête-à-tête avec ma députée, une socialiste, que j’ai songé : « Elle est nulle ! Pourquoi pas moi ? »
Et là, maintenant, je vois de près le PDG d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge, qui sue, qui hésite, qui se défile, « vos salariés sont à cinquante mètres, allez les rencontrer ! » je lui dis, lui à un mètre de moi, son malaise qui transpire, comme un poisson sorti de son aquarium.
Et le Président de la République, sur le site de Whirlpool, on se met en travers de son chemin, on l’alpague pour les contrats aidés, nos corps se heurtent, à peine mais un peu, sacrilège.
Et la ministre de la Santé, qui me persifle, qui me traite de mytho à demi-mots, et j’encaisse, je me tasse sur mon siège, un peu honteux, avant de repartir au micro : « Je continuerai à le dire, et de plus en plus fort si nécessaire, parce que vous êtes sourde à la douleur des familles », applaudi par les miens, et c’est elle qui se tait.
Le Parlement, c’est l’occasion, chaque jour, de joutes sans danger : seul l’orgueil s’y blesse.
Ça fatigue, ça épuise, les conflits, avec la masse hostile contre nous.
Qu’y gagne-t-on, néanmoins ? De l’assurance.
D’autres, dans le groupe, prennent cette assurance techniquement, par la maîtrise des budgets, par la connaissance des législations, des règlements, des alinéas.
Mais c’est la même chose, au fond : détenir les armes, les armes intellectuelles, spirituelles je dirais, pour bientôt les combattre, les convaincre d’égal à égal.
Sans cela, sans cette assurance, nous ne changerons rien demain.
Quelle est la source, avant tout, de la Révolution française ? C’est la montée en puissance de la bourgeoisie, pendant un siècle : à force de lire, d’écrire, de s’enrichir, elle prend confiance, elle s’estime l’égale des aristocrates, et s’en
va réclamer ses droits aux États généraux.
Mais même la grande jacquerie, partie de Picardie en 1358, quelle en est la cause ? C’est la bataille de Poitiers, deux ans plus tôt, en 1356. Face aux troupes anglaises, et malgré le surnombre, l’affrontement tourne à la débâcle.
Les nobles officiers ont fui, lâchement fui, abandonnant le terrain et le roi, au vu et au su de leurs paysans-soldats. La honte ! La déculottée !
Les jambes à leur cou ! Et après ça, de retour sur leurs terres, ils voulaient jouer aux seigneurs ?
Ils souhaitaient que les manants réparent leurs châteaux ? Terminée, l’obéissance ! Cette supériorité des maîtres, les Jacques n’y croyaient plus, et c’était le préalable à leur révolte.
On connaît tous la maxime de La Boétie : « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. »
Eh bien, à notre modeste mesure, nous participons à ça.
À remettre notre gauche debout.
À nous afficher comme leurs égaux.
À les faire chuter de leur piédestal, à l’occasion.
Qu’on vous offre cet exemple, malgré le tremblement, comme représentants. Qu’en un mouvement historique, et forcément lent, dont nous ne sommes qu’une étape, on fasse émerger une nouvelle élite, nous, vous, confiante, face à
l’internationale des riches et de leurs supplétifs.
C’est un choc psychologique, qu’il faut.
Le noeud est dans nos cerveaux.
Que nous soyons conscients de notre force commune, d’abord.
***
Et ça marche.
Un peu, je crois.
On vous contamine.
Hier soir, à Réaumur-Sébastopol, me jetant dans le métro, bondé, les portes m’ont arraché un bras.
Une dame m’a souri : « Ça fait du bien ce que vous faites. Continuez. »
Tous les jours, je reçois mon lot d’encouragements : « Vous, au moins, on vous comprend. » Mon préféré, le compliment qui sonne le plus juste : « Grâce à vous, on respire. » Avec une variante : « Vous êtes une bouffée d’air. » Et toujours, ou presque, accompagné d’un « ça fait du bien ».
C’est une fonction quasi-thérapeutique que mes mots, mes vidéos remplissent. De l’ordre de la psychothérapie politique.
Cet étouffement, j’y suis sensible parce que je l’ai vécu.
Adolescent, ou jeune homme, je bouillais d’une révolte. Mais qui, dans la sphère publique, portait cette parole ? Personne. Je ne me sentais pas représenté, je ne me reconnaissais dans aucune figure, orphelin. Il y avait les livres, heureusement, j’y trouvais des frères ou des pairs, chez Dostoïevski ou Bourdieu, chez Barthes ou Céline. Mais au présent, dans les médias, ma voix
était niée, mise sous le boisseau, et j’en souffrais.
Et puis, un samedi après-midi, je regardais Arrêt sur Images, alors sur la Cinquième.
Serge Halimi en était l’invité face à Jean d’Ormesson. Et quel bien ça m’a fait ! Enfin ! Enfin un homme prononçait les mots que je portais en moi et qui ne sortaient pas ! Je n’étais pas seul, pas fou ! Oui, soudain, j’ai respiré. Ce n’est pas une image : j’éprouvais un mieux-être, dans mon coeur, dans mon corps.
Un soir, dans une chambre d’hôtel, j’allume la télé et David Pujadas sermonne un cégétiste : « Est-ce que ça ne va pas trop loin ? Est-ce que vous regrettez ces violences ? », et l’autre, de Continental, Xavier Mathieu évidemment, à la place de faire son mea culpa, le voilà qui pilonne : « Vous plaisantez j’espère ? Qu’est-ce que vous voulez qu’on regrette ? Quelques carreaux cassés ? Quelques ordinateurs ? À côté des milliers de vies brisées ! » Quel bonheur,
alors ! Comme un éclair dans la nuit !
[*C’est mon tour, donc.*]
C’est notre tour, députés insoumis et communistes.
C’est notre tour d’apporter cet oxygène, et à la force de nos bras, de nos pieds, de nos porte-à-porte, nous avons conquis ça : une tribune régulière.
Rien de plus, rien de moins.
Nous ne passerons pas une loi, bien sûr, ils nous retoqueront le moindre amendement, ça va de soi. Et le travail législatif relève, pour moi, du simulacre, pour prolonger notre effort idéologique : les propositions de loi, les interventions dans l’hémicycle, les interpellations en commission ne visent pas à transformer le réel maintenant. Mais à dire, à répéter, à faire savoir que ce monde-là, nous n’en voulons plus. Et que nous en préparons un autre.
Devant nos vidéos, sur Facebook, sur Youtube, il y a des « vues » par milliers, souvent par centaines de milliers, il arrive qu’on dépasse le million. Des internautes écrivent : « Vous me redonnez confiance dans la politique », c’est un bout du chemin, ça. Parfois, nos formules sont reprises ailleurs, « président des riches », « la saignée des emplois aidés », « Robin des bois à l’envers », et l’on n’est même plus certains d’en être l’auteur, peut-être y en a-t-il plusieurs.
Bref, on sème à la volée, un peu tous azimuts.
C’est peu, on dira.
On pourrait se décourager.
Mais pour qui a, comme nous, longtemps crié dans le désert, ou du moins dans les colonnes confidentielles de Fakir, c’est formidable déjà que d’avoir une audience.
Moi aussi, je me sens moins seul.
Car ça marche dans les deux sens : vous êtes ma bouffée d’oxygène.
***
« J’ai 47 ans. J’ai rencontré un exhibitionniste à 15 ans dans le bus à Rennes qui ouvrait par surprise son imperméable. J’ai rencontré un homme en mobylette qui sous prétexte de solliciter son chemin me questionnait tout en se masturbant. Mais le pire, ce fut le médecin généraliste à Rennes, proche de la retraite qui me demandait de me dévêtir pour une simple angine. En sous-vêtements, il me demandait d’ôter mon soutien-gorge pour palper les ganglions mais le regard scrutant ma poitrine. Sans prévenir, il descendait ma culotte que je remontais instantanément. Il précisait le regard pervers ‘‘mais les ganglions inguinaux aussi mademoiselle’’ et j’en passe ! Même malade, je ne me plaignais plus et souffrais en silence. J’ai cessé toute activité sportive pour éviter d’avoir à solliciter le fameux certificat médical. J’attendais de ne plus dépendre financièrement de mes parents pour aller consulter un médecin femme. Car pour moi le véritable problème, c’est la parole bafouée. Ma maman m’a juste dit ‘‘Le médecin, il a l’habitude, il en voit tous les jours’’.
Je n’ai pas été entendue donc je me suis tue devant cette situation. Or je n’étais pas folle : ma maman n’ôtait pas ses vêtements elle pour une angine. »
Depuis deux semaines, régulièrement, je visite le site balancetonporc.com. Par voyeurisme, un peu, sans doute. Parce qu’aussi il y a ce voile qui se lève, cette omerta qui se brise, pas toujours de manière élégante, certes, mais je l’espère, pour tous les pans du monde social, la vie des hôpitaux, des entreprises, des universités. Que les injustices s’y affirment, pas seulement sur Internet, en douce, un peu sournoisement, mais de visu et néanmoins dans le respect.
C’est l’ADN de Fakir, je dirais.
Du discours direct, très direct, le plus direct possible.
J’ai longtemps cité ce propos de Philippe Gavi, fondateur de Libération, comme un emblème, lui qui voulait un « quotidien démocratique qui donnera la voix au peuple, aux ouvriers, aux grévistes, aux paysans », qui « ne parlera plus de ‘‘révolution’’ avec des stéréotypes, des idées toutes faites, des affirmations triomphalistes, mais avec toute la force explosive que la parole représente quand l’imaginaire et le réel se fondent avec les mots ».
« Au commencement était le Verbe. »
Ainsi s’ouvre l’Évangile selon Saint-Jean.
Au commencement de la démocratie aussi, se trouve le Verbe.
Or le Verbe est aujourd’hui enchaîné, contrôlé, surveillé.
***
« Chaque salarié a peur. » Christophe a parfaitement résumé ça, ce lundi soir, à Longueau, à une permanence. Christophe Guevernou, délégué CGT de la Halle aux Vêtements, qui venait de Niort, lui, rien que pour moi, avec une collègue de Thionville, et un autre CGC de Paris.
Ça me scotchait, cette traversée de la France pour ma pomme. Dans les magasins d’Amiens, ils m’annonçaient, des postes seraient supprimés.
Ils espéraient que je résiste à leurs côtés, et vu le gasoil qu’ils avaient consommé, j’y étais plutôt enclin :
« Mais localement, est-ce que des employés sont prêts à se bouger ? » j’interrogeais.
C’est là que Christophe m’a répondu, comme un adage, comme une évidence, comme une loi universelle : « Chaque salarié a peur. » Et il a poursuivi : « Dès que vous levez la main, ou on vous tape dessus, ou vous la rabaissez. »
Et hier, à Rue.
Des ouvriers du bâtiment.
Leur boîte va mal.
Ils nous retrouvaient, en catimini, le midi, au coin
du Lidl en face.
Ils étaient six.
Six sur trente-sept.
« Les autres ne viendront pas. Ils ne diront rien au patron. Ils ont peur. »
J’ai relevé, évidemment.
Un cégétiste, qui avait un peu de bouteille, s’en est amusé : « Tous les jours, j’entends ça. Moi, ça me fait penser à Roger Gicquel, quand il avait lancé “La France a peur” après le meurtre commis par Patrick Henry.
— Moi, ça me fait penser, j’enchaîne, à Henri Krazucki, qui à propos du chômage déclarait : “La peur a changé de camp.” »
Mais nous ne pouvons rien comprendre à la France, à la France d’aujourd’hui, si nous ne saisissons pas cette peur, cette peur qui ronge les coeurs, cette peur qui rétrécit les esprits, cette peur qui enlaidit le pays.
***

[*Qu’est-ce que je fous à l’Assemblée, alors ?*]
Souvent, je me demande.
Je geins, je me plains.
Plein de trucs nous emmerdent.
Trop de réunions bidons, qui nous enferment, au secours ! j’étouffe !
Mais dans les interstices de cet ennui parlementaire, comme le chiendent pousse entre deux pavés, comme le diable surgit de sa boîte, tel est mon rôle, ma petite utilité, à ma mesure, ma pierre à l’édifice, je crois : libérer ma parole pour libérer la vôtre.
Non pas pour dire tout et n’importe quoi, une logorrhée, un comptoir permanent. Au contraire, peu mais bien, les mots qui vont à l’âme, à l’os, au nerf, pour qu’à votre tour, camionneurs de chez Mory, ouvriers de chez Whirlpool, soignants du CHU, vous prononciez les mots qui vous rongent, qui pourrissent en vous, que vous les exprimiez, exprimer au sens littéral, que vous les poussiez dehors, comme un poids, comme une douleur, comme une tumeur. Que Claude et Patrice les aient en face, les dirigeants de Mory-Ducros, et Montebourg dans la foulée, qu’ils balancent leurs quatre vérités, qu’ils échangent en égaux, enfin, sans mépris, sans arrogance.
Et qu’en attendant ce jour, je les représente, symboliquement, que je le fasse à leur place, avec le dirigeant qui me tombe sous le coude.
[*Tant qu’à faire.*]
Puisqu’on en est à l’Évangile.
Pourquoi pas le pape ?
« N’ayez pas peur ! »
J’ai des loisirs bizarres : sur les archives de l’Ina, ce dimanche, je regardais l’intronisation de Jean-Paul II, à Rome, en 1978 : « N’ayez pas peur ! Ouvrez ! Ouvrez toutes grandes les portes du Christ ! Ouvrez ! Ouvrez les frontières des États ! N’ayez pas peur ! »
J’écoutais ce discours parce que, en un sens, c’est le même message que je veux transmettre.
Dans un autre genre, certes, le Christ en moins, la foi aussi malheureusement, pas depuis le trône de Saint-Pierre, pas devant une foule de fidèles, mais pareil : « N’ayez pas peur ! »
Je changerais la conjugaison, peut-être, je m’inclurais, à la première personne du pluriel : « N’ayons pas peur ! » Car je fais partie, encore, du peuple des peureux.
Mais on se soigne, non ?



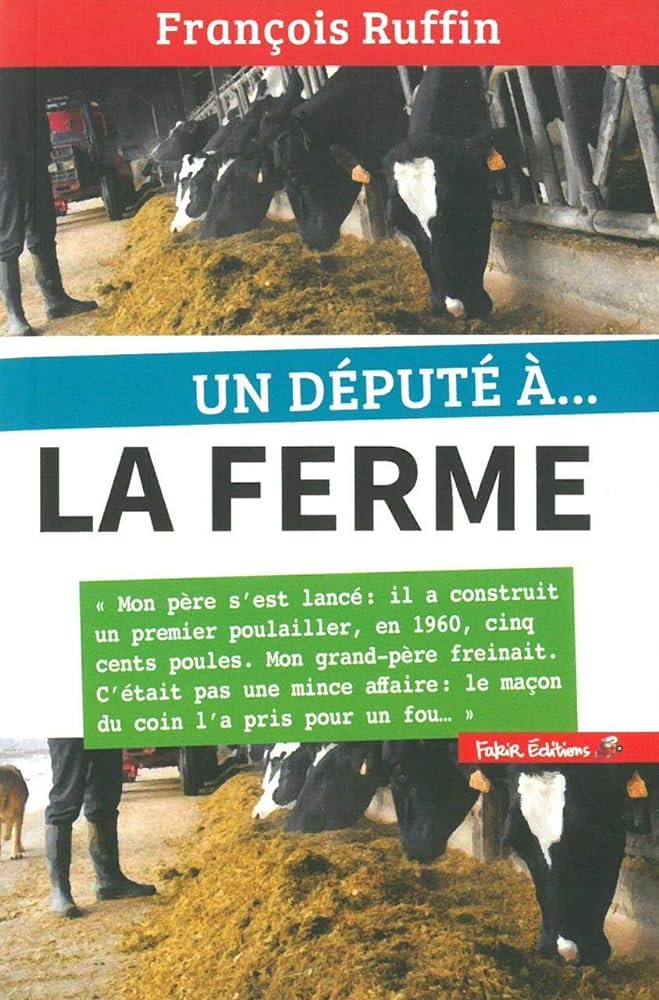





Messages
5 avril 2018, 22:11, par Vaughan
çà me fait du bien de lire ce que tu dis
la manière ouverte dont tu parles de ton lot
sois sage, sois fort, sois toi :
que la bonne chance te bénisse
que tu continues à chauffer le coeur de ce vieux syndicaliste