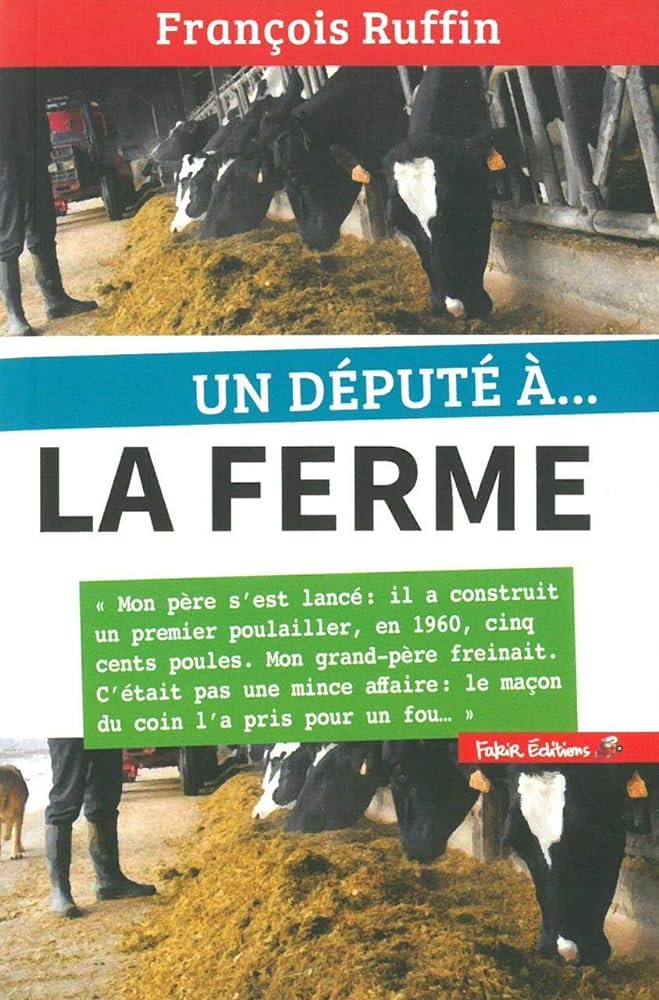L’État Ponce Pilate
par 16/03/2018 paru dans le Fakir n°(82) Date de parution : septembre octobre 2017

On a besoin de vous
Le journal fakir est un journal papier, en vente dans tous les bons kiosques près de chez vous. Il ne peut réaliser des reportages que parce qu’il est acheté ou parce qu’on y est abonné !
Des salariés maltraités ? Un patron encore à l’âge de pierre ?
L’État s’en fout, et tel Ponce Pilate s’en lave les mains.
C’est la nouvelle doctrine : ne pas intervenir.
La preuve avec l’Ehpad de Foucherans et ses 115 jours de grève...
Récit d’une négociation, et de ses coulisses.
Mercredi 19 juillet, Assemblée nationale
Dans l’hémicycle, on examinait un projet de loi « ratifiant l’ordonnance n° 2017‑31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ».
Je ne comprenais rien au titre.
Rien au texte.
Rien aux amendements.
Comme souvent. Les députés de la majorité votaient en cadence. Chez les Insoumis, peut‑être que Caroline et Adrien suivaient, eux qui avaient déjà aperçu le document dans leur Commission des affaires sociales.
Moi, je faisais semblant.
Je m’ennuyais.
Je glandouillais sur les bancs, jusqu’à ce courriel, transmis ce matin‑là, par Sylvain, à 10 h 47 :
Date : 19 juillet 2017 à 10 :38
Objet : Les Opalines (Foucherans, Jura, 39),
en grève depuis le 3 avril
À : communication@picardiedebout.fr
Si tu ne sais pas quoi faire pendant les vacances,
va faire un tour dans le Jura. C’est très joli et tu
pourras soutenir les employées de l’Ehpad qui
viennent de franchir la barre des 100 jours de
grève
Y était joint l’article de Florence Aubenas, paru le jour même : « On ne les met pas au lit, on les jette », « Il m’arrive d’en nourrir cinq six en même temps. J’ai l’impression de faire du gavage », « La douche hebdomadaire, c’est rare qu’on la tienne »...
Durant ma campagne, à plein de reprises, en maison de retraite, à l’hôpital, en psychiatrie, j’avais entendu cette expression, « maltraitance institutionnelle », de la part de soignants qui regrettaient de la faire subir, cette maltraitance, à leurs patients, qui en culpabilisaient, qui en pleuraient parfois.
Et si on leur causait de ça, aux parlementaires ?
Et pas seulement de l’« ordonnance qui rend applicables aux conseils nationaux de tous les ordres les principes de la réglementation des marchés publics, fixés par l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ?
Je sors choper Le Monde à la bibliothèque, pour le brandir, s’assurer un effet visuel. Oui, que vous dire ?, que bien sûr c’est aussi de la mise en scène.
Grâce à Sylvain, via Aubenas, on appelle Anne‑Sophie Pelletier, aide‑soignante
là‑bas, porte‑parole du mouvement :
« Ah, monsieur Ruffin ! Mais on vous attendait... on vous a écrit...
— Ah bon ?
— Oui, mi‑juin.
— Ah merde... »
Et elle me déballe en vrac les infractions de son groupe, la SGMR, « ils ont 77 résidents à la place de 75 », « ils font de l’accueil de jour pour les troubles cognitifs mais sans accord », « ils reçoivent une dotation pour 19 postes mais on en a que 14 », « où passe l’argent public ? Notre Ehpad a fait 329 000 € de bénéfices, l’an dernier, sur 3,4 millions de chiffre d’affaires. Et Mennechet, notre PDG, c’est la 400e fortune française ».
Mais c’est un autre fait qui retient mon attention :
« Vous en êtes à cent jours de grève...
— Cent dix...
— Et l’ARS intervient ?
— Au début, oui, ils ont débloqué deux postes, mais
maintenant nous n’avons plus de nouvelles...
— Et le ministère ?
— Rien. On lui a écrit le 30 juin, mais
nous n’avons pas de réponse.
— Et vos députés ?
— Ils ne sont jamais passés nous voir.
— Donc, entre votre direction et vous, qui sert de médiateur ?
— Personne. »
Ça me paraît un symbole, pas seulement pour Foucherans, ni pour la santé, mais pour toute la France : la non‑intervention est érigée en doctrine.
[*De retour dans l’hémicycle*],
je monte à la tribune :
« Madame la ministre, ces personnes vous ont écrit il y a trois semaines maintenant. J’aimerais que vous profitiez de la tribune qui vous est offerte ce soir, à l’Assemblée, pour apporter une réponse aux difficultés qu’elles rencontrent, à leurs pleurs après cent jours dans une tente. »
Mon désir, c’est de susciter une médiation.
Ministérielle, ou sinon parlementaire :
« Par ailleurs, je m’adresse à mes collègues de La République en Marche. Je me propose d’aller à la rencontre de ces soignantes, dans le Jura.
Sur des sujets comme ceux‑là, on peut travailler ensemble, donc je souhaiterais qu’un député En Marche nous accompagne, on a le train gratuit, et qu’on se rende le plus vite possible à Foucherans... Eh bien, très bien... Nous irons ensemble avec Madame, et avec Monsieur. »
Deux élus se montrent volontaires.
Youpi ! On va partir en balade le mardi ! J’ai besoin de m’échapper...
Jeudi 20 juillet, ministère de la Santé
Comme, à l’Assemblée, Agnès Buzyn n’a pas répondu, on se rend avec Caroline au ministère de la Santé.
On patiente dans le hall.
Au standard.
Et puis Anne Beinier, conseillère de la ministre, descend : « Madame Buzyn est à Tallinn, en Estonie, aujourd’hui... Mais c’est convenu avec elle, elle vous répondra mercredi prochain.
— Mercredi prochain ! Mais c’est pas à moi qu’elle doit répondre, c’est aux aides‑soignantes ! Vous vous rendez compte, on a des dames, elles sont dans une tente, ça fait trois semaines qu’elles vous ont écrit, et vous, pour leur dire quelques mots, ça doit prendre encore sept jours... Sept jours dans le froid, dans le chaud...
— Madame Buzyn est à une réunion de ministres européens, alors...
— Ça fait plus de trois mois qu’elles sont en grève ! Et vous n’intervenez pas ! Trois mois, vous vous rendez compte !
— Je me rends bien compte. »
Ça m’énerve.
J’ignore si c’est volontaire ou non, si c’est une stratégie ou de l’incompétence, mais ça porte un nom : le pourrissement.
Mardi 25 juillet, Foucherans, piquet de grève
« On nous laisse pourrir depuis quatre mois ! »
C’est le sentiment qui règne, ici, sur le piquet de grève.
Je laisse de côté la maltraitance, des patients et des soignants, dont ils témoignent à notre « Commission d’information délocalisée ».
On en parlera dans un prochain numéro.
Je reste sur mon angle : la non‑intervention.
« La direction se moque de nous : ‘‘Votre grève, c’est du vent ! elle nous lance. On ne lâchera rien...’’ C’est du mépris permanent.
— L’ARS est venue sur place ? je demande.
— Non.
— Le Conseil départemental ?
— Non. Ils considèrent que c’est une lutte privée entre patrons et salariés, qu’ils n’ont pas à intervenir.
— Y a pas un syndicat des Ehpad ?
— Si, le Synerpa. Mais les Opalines ne veulent pas y adhérer, et le Synerpa les a condamnées. Au début, l’ARS a fait son boulot : ils ont rajouté deux postes d’aides‑soignantes, et c’était une énorme avancée, ça améliorerait nos conditions de travail. Il restait un point à régler : nos primes. On voulait 100 € en plus par mois, c’était non. 27 € pour le dimanche, c’était non. Et l’ARS, là, nous a apporté du grain à moudre : il y a, apparemment, des crédits que les Opalines n’utilisent pas, un genre de trop‑perçu, grâce au sous‑effectif depuis des années.
L’ARS a proposé que ça soit réparti entre les salariés puisque, après tout, c’est nous qui avons trimé pour dégager ces sous. La direction a refusé. Enfin, lors d’une autre réunion, c’était avec la Direccte, on s’est mis d’accord sur 600 € par gréviste...
— Vous acceptiez de reprendre le travail contre 600 € par personne ?
— Voilà.
— Et c’était quand ?
— Y a deux mois.
— Donc ça ne remboursait pas vos mois de grève ?
— Ah non, très loin de ça !
— Et cet accord a capoté, finalement ?
— Bah oui. Le lendemain, le directeur nous annonçait que les 600 €, c’était en brut. Ça laissait 375 € en net ! Faut pas se foutre de nous !
— Et depuis ? Les autres réunions, ça a donné quoi ?
— On n’a plus de nouvelles de personne. Ils nous ont laissés à l’abandon. » Faut comprendre ça, surtout : l’orgueil.
C’est ce qui se joue, entre 375 et 600 €.
D’un côté, ne pas rentrer la tête basse.
De l’autre, ne pas plier face aux salariés
Mardi 25 juillet, Foucherans, les Opalines
Comme convenu au téléphone la veille, on rend visite à la direction.
Les caméras nous ont devancés, de LCI, de BFM, des micros aussi.
C’est pour cette raison que les députés d’En Marche ! nous ont lâchés : parce
qu’ils redoutaient « la médiatisation ».
Soit.
Mais c’est également une arme, à l’évidence, dans le rapport de forces.
Aujourd’hui, le directeur, un grand directeur, qui gère 46 établissements, s’exprime publiquement pour la première fois.
Et il a l’air penaud.
Comme un petit garçon qui aurait pris une fessée.

« On est devenus le symbole de la maltraitance en France, et ça n’est vraiment pas juste, parce que tout le personnel, les aides‑soignantes, les cadres font de leur mieux...
— Oui mais pourquoi vous êtes devenu ce symbole ? je le tance. Vous le savez bien pourquoi...
— Parce qu’on a une grève ici, il soupire.
— Et qui dure depuis cent jours ! j’enfonce le clou. C’est de votre faute ! »
C’est sadique, peut‑être, mais faut l’avouer : ça fait plaisir. Ces mecs en complets gris, qui dominent toujours, qui te regardent de haut, avec arrogance, avec sérieux, et là, c’est nous qui lui faisons la leçon.
« Allez comparer avec les autres Ehpad, il nous enjoint. Les douches, chez nous, on fait notre possible pour que...
— Écoutez, on reverra les soins apportés aux personnes âgées, dans le pays, un autre jour.
On envisagera d’autres modes de garde pour le vieillissement, etc. Tout cela sera fort instructif, passionnant, mais aujourd’hui, on n’a pas le temps.
Aujourd’hui, on est là pour sortir d’un conflit, qui dure depuis une éternité, qui vous apporte de la mauvaise publicité à chaque journée...
— Eh bien justement, je suis là pour ça. »
Ah bon ?
« Mais excusez‑moi, vous êtes qui, vous ? On ne s’est pas présentés...
— Vincent Chagué. Je suis maître de conférences en management à l’Université de Limoges. Je forme les cadres de santé, les directeurs. J’ai monté ma propre entreprise. Et c’est à ce titre‑là que la direction des Opalines m’a demandé de venir, pour une médiation.
— Très bien. Vous avez rencontré les grévistes ?
— Je viens d’arriver ce matin. »
Notre venue et les médias auront donc servi à ça, au moins.
« Je compte bien aboutir d’ici vendredi. »
Lui aussi est pressé de partir en vacances !
Devant les caméras, à la sortie, je le mets en valeur, en évidence.
Maintenant, je ne me leurre pas : loin d’être neutre, ce médiateur a un client.
Il est payé par l’entreprise.
C’est son directeur qu’il doit satisfaire.
Mardi 26 juillet, Facebook
« De la politique spectacle. » Je découvre un communiqué de Danielle Brulebois,
vice‑présidente En Marche ! de l’Assemblée nationale, députée du Jura, et qui nous flingue,
Caroline et moi :
« Les revendications, souvent légitimes, des soignants pour leurs conditions de travail ne doivent pas être instrumentalisées à des fins politiciennes. Ces combats des professionnels de la gériatrie méritent mieux qu’une politique spectacle qui ne fait que multiplier les désaccords et les rancoeurs. »
Soit, d’accord.
On peut ne pas apprécier mon côté « opération coup de poing ».
Des maladresses, j’en commets.
M’enfin, ce sont les planqués qui critiquent les soldats qui montent au front. Parce qu’elle a eu 115 jours, madame Brulebois, voisine de Foucherans, dans sa campagne d’abord, comme députée du département ensuite, pour prendre le dossier à bras‑le‑corps, pour discuter avec les soignants, avec la direction, pour mettre tout le monde autour de la table, pour jouer les intermédiaires.
Discrètement, si elle le souhaite.
Dans son style à elle, sans doute plus convenable que le mien.
Pas un orteil, qu’elle a bougé.
Pas un signe de solidarité, qu’elle a montré.
Et elle ose l’ouvrir ?
Mercredi 27 juillet, Assemblée nationale
Ça s’appelle déminer le terrain.
C’est une députée d’En Marche !, Anne‑Christine Lang, qui pose, d’emblée, la question à la ministre de la Santé, elle le fait avec éloquence, sur « les soins qu’on ne peut assurer », « les sonnettes qui sonnent trop souvent dans le vide ». Agnès Buzyn lit sa fiche : « J’ai demandé au directeur régional de la santé de faire le lien avec le directeur général du groupe privé qui gère cet établissement et avec le personnel de façon à aboutir à une solution. »
À la sortie de cette séance, je la croise et comme convenu, on s’installe sur un banc.
« Il y a un dysfonctionnement RH majeur... ça va bien au‑delà de la maltraitance... ils ne font pas partie de la communauté des Ehpad... » En deux minutes, la ministre flingue gravement les Opalines. Bien plus que je ne l’ai jamais fait, publiquement.
« Mais alors, quelle réponse vous apportez à leur courrier ? Qui est un appel au secours...
— Je ne rentre pas dans une négociation privée. »
Voilà énoncé le coeur de la doctrine.
Et on mesure le paradoxe : ces gens sont des salauds, mais c’est pas mon affaire !
« Je laisse le médiateur faire son travail. »
Mais quel médiateur ?
Ça devient confus...
M. Chagué, nommé par l’entreprise ?
« Il y a un médiateur de missionné, M. Pibrile, le directeur de l’ARS. Il a ma totale confiance. C’est quelqu’un de respecté, de sérieux... »
Enfin !
Au 116e jour l’État s’en mêle !
Le lundi, on n’avait aucun médiateur, et voilà qu’on en a deux.
De mon côté, je veux une info : le montant du trop‑perçu par les Opalines.
Que les salariés disposent de cette carte.
Qu’elles puissent négocier en conséquence.
La ministre est gênée : « Vous comprenez que vous êtes député de la Nation, certes, mais il y a une députée de la circonscription... »
Mais qu’elle n’hésite pas à s’impliquer, surtout !
Dans la foulée, Anne‑Sophie, l’aide‑soignante, m’appelle : « Je me suis engueulée avec le médiateur...
— Lequel ?
— Leur gars, là, Chagué.
— Je te demande parce que la ministre, apparemment, a nommé un autre médiateur...
— Il veut qu’on signe toute de suite, mais il n’offre rien de mieux, toujours 600 € brut. Y en a qui ont claqué la porte.
— À mon avis, reste calme. Mais ne signe rien avant vendredi, ça peut évoluer... »
Jeudi 28 juillet, couloirs de l’Assemblée
Avec des allers‑retours entre l’Hémicycle et les couloirs, je passe des coups de fil tous azimuts : à Anne‑Sophie, à l’ARS, à Chagué, à Aubenas...
Faut avouer : comme dans Merci Patron !, j’aime bien les embrouilles des négociations, le billard à quatre bandes, ça me rappelle les jeux de rôle.
À l’ARS, je joins une secrétaire, et c’est carrément
surréaliste :
« On a donné les chiffres du trop‑perçu au négociateur...
— À qui ? A M. Pibrile ?
— Non, à M. Chagué. »
Merde !
La ministre m’a annoncé, la veille, que le directeur de l’ARS était le médiateur.
Je téléphone à l’ARS qui me déclare quoi ?
Que ça reste M. Chagué !
Et l’absurde ne s’arrête pas là :
« Mais à quoi ça sert de lui donner ces chiffres ? Il est missionné par l’entreprise, donc lui les a déjà.
— Je sais bien.
— Mais c’est pas certain qu’il les livre aux salariés.
— Je sais bien.
— Moi, je voudrais rétablir un équilibre dans la négociation, que les grévistes disposent des mêmes données.
— Je sais bien.
— Vous ne pouvez pas considérer comme ‘‘neutre’’ un médiateur privé, payé par l’entreprise.
— Je sais bien. »
Chagué, de son côté, est un rien déprimé :
« On ne s’en sort pas, il se plaint.
— M’enfin, 600 €, votre client il se rend compte que c’est une misère ? Les filles ont plus de trois mois de grève, et tout ce qu’elles réclament pour rentrer, c’est 600 € ?
— Je sais bien. »
Lui aussi.
« J’essaie de faire entendre raison au directeur, mais il ne veut pas céder.
— Mais on va encore lui mettre le bazar ! On va faire la tournée des Ehpad de son groupe avec les journalistes !
Ça lui plairait, ce programme ?
J’ai reçu des messages de soignants, de familles, ailleurs en France, et qui protestent...
— Vous pourriez me les transmettre ? Ça pourrait le faire fléchir. »

Florence Aubenas est retournée sur place, aujourd’hui, et elle partage
mon diagnostic : le plus stupéfiant, dans ce dossier, c’est la démission de l’État.
On a un patron qui écrase, d’accord, ultra‑rigide, et on ne va pas dire que c’est la règle, mais ça existe.
En revanche, où est l’État pour faire tampon ?
Anne‑Sophie ne sait plus quoi faire : signer ? Pas signer ?
Elle ne supporte plus Chagué.
Je la sens au bord de la crise de nerfs.
En faisant les cent pas, dehors, dans les cailloux des allées de l’Assemblée, j’analyse la situation avec elle : « Si Chagué se barre, et même si c’est à cause du directeur, qu’est‑ce qu’il va dire ? Que c’est de votre faute, que vous êtes sectaires, qu’on ne peut pas négocier avec vous, etc. Il va vous rejeter la faute, c’est logique, l’autre c’est son client. C’est tout le souci d’avoir un médiateur qui n’est pas neutre mais, malheureusement, c’est un fait. Il faut faire avec. Ça donnera une raison de plus à l’État pour se défausser, la presse locale va vous montrer du doigt, et votre conflit va se perdre dans les vacances du mois d’août...
Si vous signez aujourd’hui, bon, on va pas se mentir : vous serez financièrement perdantes. En euros sonnants et trébuchants, y aura presque rien dans l’accord. Mais vous serez moralement victorieuses.
Grâce à vous, dans toute la France, on aura parlé des conditions de vie dans les Ehpad. Vous avez une bonne image dans les médias, dans l’opinion. Vous allez pouvoir en sortir fières de vous, le front haut, prêts à l’avenir pour de nouvelles batailles. D’autant que, et à mon avis c’est la principale conquête, vous allez pouvoir fonder une section CGT, la faire tourner, tandis que Melissa s’était fait virer pour ça... »
Me vient à la bouche, même, la phrase de Thorez : « Il faut savoir arrêter une grève », et en l’occurrence, « même lorsque les principales revendications n’ont pas été satisfaites ».
[*Dans l’après‑midi, Anne‑Sophie a signé.*]
À la fois soulagée et en pleurs.
Lançant un « On a gagné » à ses camarades.
J’ai publié un papier dans le même sens.
Florence Aubenas pour LeMonde.fr aussi.
Et ce fut la tonalité des journaux.
« Elles ont gagné. »
C’est bizarre, non ?
Je suis supposé être un extrémiste, un boutefeu, un agitateur, et là j’ai poussé à un compromis plus que bancal. Sans remords : il faut compter avec le rapport de forces, et là il n’était pas en leur faveur. À cause de quoi ? De l’État. De son absence.
Le soir, trop tard, le directeur de l’ARS m’appelle.
Et c’est éclairant :
« Comme c’est un conflit employeur / salariés, on s’est d’abord dit : ‘‘C’est à eux de s’entendre.’’ Mais au bout d’un mois, on a vu que ça ne fonctionnait
pas. Nous avons donc provoqué une réunion, mais au bout de cinq minutes, on a tout de suite compris : l’entreprise ne savait pas ce que c’était, le dialogue
social. Jamais je n’avais vu ça à ce niveau.
On a assez vite dégagé huit ou neuf points, d’autant qu’on disposait d’une marge de manoeuvre : cet Ehpad faisait remonter des crédits, ne les consommait pas, par pure mauvaise gestion. Donc on pouvait financer des postes, ou remplacer les absences... Et là j’ai dit : ‘‘Il va bien falloir une prime de fin de conflit’’, et d’un coup, j’ai vu l’employeur se raidir. Et la rencontre avec le Préfet a achoppé sur quoi ? Sur est‑ce que c’est du brut ou est‑ce que c’est du net ? Je veux dire, on est à un niveau de management, c’est l’âge de pierre. Il faut voir le turn‑over de personnel.
Alors, bon, je ne serai pas aussi dur que vous, quand vous dites que l’État s’est retiré. Pour moi, il y a eu des tentatives, mais assez désordonnées, assez éparpillées. Le dialogue social ne s’est jamais engagé. C’est que nous ne sommes pas habitués à des entreprises de cette nature... »
[*Comment imaginer pire ?*]
L’ARS, le Préfet savent, là, que l’employeur déconne.
Qu’il méprise ses salariés, arrogant avec les grévistes.
Que le pourrissement lui est imputable.
Et pourtant, durant trois mois, on les laisse dans un face‑à‑face.
Ou plutôt : on les renvoie dos à dos.
Tel Ponce Pilate, l’État s’en lave les mains.
N’intervient pas sur la scène publique.
Ne délivre sa vérité que là, maintenant, sans éclat.
Et le médiateur finalement proposé, en une fausse neutralité, est à la solde du patron : le « compromis » trouvé est, surprise, favorable à son client.
Malheureusement, ici, je ne voudrais blâmer aucun individu.
Ni le directeur de l’ARS.
Ni le préfet.
Ni la ministre.
Ni la députée.
C’est pire.
C’est une psychologie collective qui traverse le pays, qui s’est emparée du corps social :
« Je ne rentre pas dans une négociation privée. » « C’est un conflit employeur / salariés. »
C’est une idéologie qui a résonné, durant quinze jours, pendant toute la loi Travail, à l’Assemblée nationale : à quoi bon des syndicats ? à quoi bon le regard de l’État ? à quoi bon des accords de branche ? à quoi bon l’impératif de la loi ? C’est le refrain qu’on entendait sur les bancs d’En Marche ! : « Les salariés sont grands, les entrepreneurs sont responsables, ils savent mieux que nous ce qui est bon pour eux et pour leur entreprise. »
Eh bien non.
Il faut des tiers, l’État, ses représentants, l’inspecteur du travail, voire des syndicats, pour s’interposer entre l’employeur et ses salariés, pour renforcer les faibles et raisonner les forts, pour ne pas laisser les Anne‑Sophie de tout le pays croupir cent jours et plus sans secours.
[*En 1841, le rapport du médecin*]
Villermé recommandait qu’on en finisse avec le travail des enfants. Et que, pour
cela, on crée un corps de fonctionnaires à même d’inspecter dans les usines.
Le député conservateur De Beaumont protestait alors : « C’est le premier pas vers une voie qui n’est pas exempte de périls. C’est le premier acte de
réglementation de l’industrie qui, pour se mouvoir, a besoin de libertés. L’inspection du travail serait encore plus dangereuse que les grèves. Soyez‑en sûrs, bientôt ils réglementeront le travail des enfants. »
Avec « bienveillance », amabilités et sourires, les Marcheurs sont les De Beaumont d’aujourd’hui