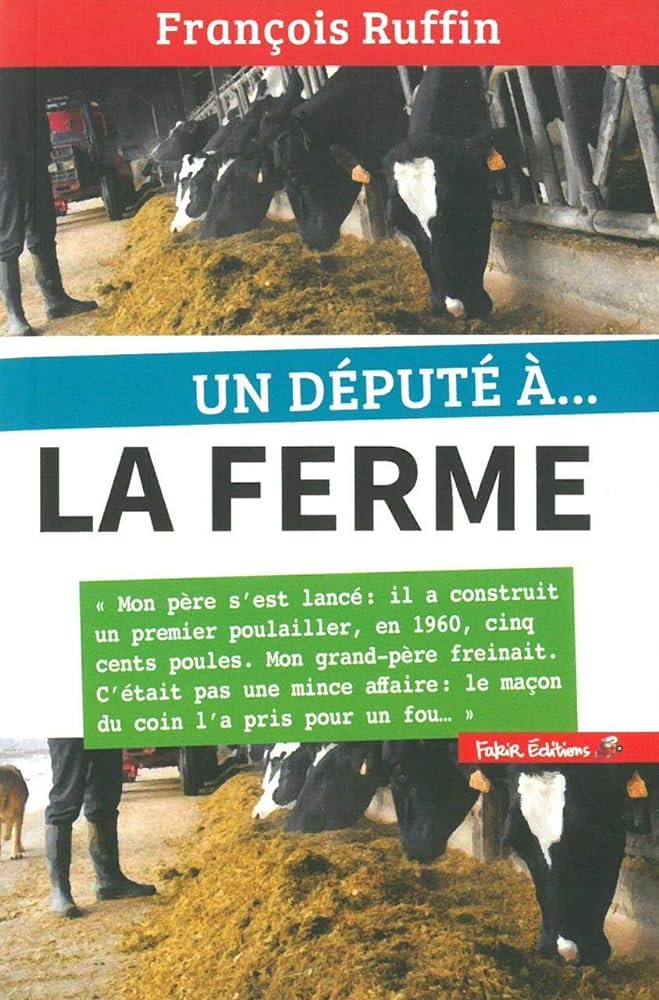Jean Teulé : "Je me réveille quand j’ai fini mon rêve"
par , 21/10/2022

On a besoin de vous
Le journal fakir est un journal papier, en vente dans tous les bons kiosques près de chez vous. Il ne peut réaliser des reportages que parce qu’il est acheté ou parce qu’on y est abonné !
Jean Teulé s’est barré. Son air d’éternel ado rêveur va nous manquer.
Son talent gentiment déjanté aussi, que, tout gosse, on avait découvert à la télé, puis comme écrivain, et quel écrivain bordel !, avec Darling, Je, François Villon, Le Montespan, Mangez-les si vous voulez…
Alors, on est d’autant plus heureux, ou un peu moins tristes, d’avoir vécu avec lui une aventure : la réédition, y a deux ans, de Gens de France, peut-être sa grande œuvre, avec dedans le soutien-gorge de Zohra, la soucoupe de Jean-Claude... Une source d’inspiration pour toute une génération de journalistes, et pour Fakir ! « Découvrant ça à vingt ans, je m’étais dit : ‘‘Je voudrais devenir Jean Teulé…’’ », raconte souvent Ruffin. Du coup, il ne s’était pas fait prier pour le rencontrer, longuement, au moment de la réédition. C’était fin 2020...
François Ruffin : Je suis vachement heureux parce c’est mon Noël avant Noël ! C’est ma parenthèse poétique au milieu du budget : je reçois Jean Teulé. Moi, depuis mes vingt ans, tu m’accompagnes. A distance, évidemment, mais je suis tombé dans une bibliothèque sur ton bouquin Gens de France. A un âge où l’on se cherche, où l’on ne sait pas trop quoi faire de son existence… Je l’ai lu à la bibliothèque, donc, et j’ai hésité à le piquer. Mais je me suis dit : « Ça veut dire qu’il y a des tas de gens, derrière, qui pourront pas être transformés à leur tour par ce bouquin. » Mais il avait disparu, il était épuisé.
Ce livre, c’est une série de photoreportages baroques, tu rencontres des gens fous, des situations loufoques, et pas loin de chez nous. Moi, je me suis dit : « Je voudrais faire ça. Je voudrais devenir Jean Teulé », et il y a des moments, dans mon parcours, pour Fakir, pour Là-bas si j’y suis, où je me suis dit : « Tiens, je fais du Teulé. » Comment ça t’est venu, cette forme ?
Jean Teulé : C’est venu par hasard. Je travaillais pour un mensuel de bande dessinée, Circus. Un jour, ils voulaient faire un « spécial star ». Ils avaient demandé à chaque dessinateur de choisir une vedette, alors tout le monde prenait un chanteur, une artiste, Marylin Monroe... Moi, c’était le moment de l’affaire Villemin et tout. Je me suis dit : « Putain, si y’a une star en France, c’est Christine Villemin ! » Et j’étais parti en pleine Vologne faire un truc là-dessus.
Comme je connaissais les gens de Hara-Kiri, en fin de matinée, je passe là-bas et je croise Gébé. J’avais mon carton à dessins. Il me demande :
« C’est quoi que tu as là ?
— C’est un truc que je vais apporter à Circus.
— Tu me fais voir ? »
Il lit et il dit :
« Je le garde.
— Bah non, c’est pas possible, j’ai rendez-vous tout à l’heure, il faut que je leur donne.
— Mais non, de toute façon c’est des cons à Circus, c’est pas pour eux, c’est pour nous.
— Faut vraiment que je leur rende, autrement ce ne serait pas bien. »
Et il conclut : « Bah je te laisse les reprendre mais à condition qu’à partir du mois prochain, tu fasses la même chose pour nous. » Et c’est parti comme ça.
réédité aux éditions Fakir, est disponible en librairie
et sur notre boutique en ligne
F.R. : On va prendre des exemples. Là, il y a un truc que tu appelles « le syndrome de Jeanne d’Arc ».
J.T. : C’était à Sierck les Bains. Les gens étaient à genoux, dans la rue, ça devenait un lieu de pèlerinage, pourquoi ? Parce que sur un mur, ils apercevaient le visage du Christ. Mais en fait, c’était quoi ? Une canalisation des chiottes qui avait pété, ça avait traversé la cloison, fait des taches d’humidité sur le mur, et les gens vénéraient ça !
F.R. : Là, tu conclus… Je le lis, parce qu’il faut montrer ton écriture, aussi : « Bordel ! Faut il qu’ils soient malheureux tous ces gens pour croire en tout ça et voir partout ce qu’ils cherchent absolument : un leader, un parti, un pays, un messie. Remarquez, moi je n’ai pas à frimer, j’ai bien cru voir des Saintes vierges en des pétasses à gros cul. Je suis fou, nous sommes tous plus ou moins fous. »
J.T. : Et ouais.
F.R. : Et donc voilà. Y a à la fois une cruauté, une cruauté à l’égard des gens, et une cruauté que tu t’appliques à toi-même. Tu ne t’exclus pas de cette commune humanité, avec ses travers.
J.T. : Exactement. Baudelaire, qui détestait tout le monde, disait « mécontent de tous et mécontent de moi ». Il ne s’oubliait pas, il se mettait dedans. On fait partie de la même sauce.
F.R. : Et c’est toujours un mélange de cruauté et de tendresse, les deux à la fois… Là, un gars arrive dans un bled, à Clémery, entre Metz et Nancy, il proclame « je suis le Pape », et les gens finissent par le croire, le traitent comme le Pape, il se construit une chapelle, promulgue des encycliques... Ou alors, la dame du pont blanc, dont tu résumes l’histoire comme ça : « La voiture roule sur le pont Albert Louppe lorsque soudain, l’autostoppeuse dit au conducteur ‘‘arrêtez-vous’’. Il s’exécute, la femme descend et lui avance avant de disparaître ‘‘C’est ici que je me suis tuée il y a trois ans.’’ » Il y a souvent un côté mystérieux. Les gens que tu rencontres sont fêlés et, comme on dit, c’est par là que passe la lumière.
J.T. : J’avais envie de raconter comment les gens se démerdent, comment ils essayent de sauver leur peau, comme ils peuvent. Par exemple, j’aimais beaucoup cette histoire : le soutien-gorge de Zohra.
F.R. : Oui, elle est extraordinaire.
J.T. : Zohra avait seize ans, elle vivait dans une famille de Harkis avec un père autoritaire. Elle a besoin d’un soutien-gorge, mais elle n’ose pas le dire à son père. Donc, pendant des courses au Mammouth, elle en vole un. Comme elle n’est pas habituée, elle se fait gauler. Elle demande « pardon, pardon », comme elle avait un petit peu de sous elle paye le soutien-gorge. Mais pour les vigiles, ça ne suffisait pas, ils lui disent : « Va chercher ton père, nous on garde tes deux sœurs. » Elle pleure, elle les supplie, « non », ils se foutent de sa gueule, « eh, bouboule… », parce qu’elle est un peu grosse, « bouboule, va chercher ton père ». Alors, la gamine, déjà qu’elle n’osait pas dire à son père qu’elle avait besoin d’acheter un soutien-gorge, maintenant, lui avouer qu’elle l’avait volé ! Elle est passée sur un pont, je crois que c’était à Chalon-sur-Saône, et elle s’est balancée à la flotte.
Je m’étais amusé à les faire chier, au Mammouth. A un moment, je les appelle :
« La petite Zohra, qui vous avait piqué le soutien-gorge, finalement elle l’a payé ?
— Ouais.
— Bon après le père, quand il arrive, et que vos vigiles lui disent ‘‘votre fille elle a volé le soutien gorge’’, là, il a à nouveau payé le soutien gorge ?
— C’est vrai, oui.
— Donc, vous l’avez vendu deux fois le soutien-gorge. Mais qu’est-ce que vous en avez foutu, au fait, du soutien-gorge ?
— Bah, on l’a remis en rayon.
— Donc vous l’avez vendu trois fois ! Et c’est elle la voleuse ? »
Quand j’avais publié cette histoire, j’avais dit que, pour la date anniversaire de la mort de la petite Zohra, ça serait bien que les gens accrochent des soutiens-gorge sur sa tombe. Et j’ai appris que ça se faisait. Et ça, je trouvais ça vraiment beau.
F.R. : Et quel fossé entre la chair que tu donnes à ce fait divers, à ces vies ordinaires, et le récit dans la presse locale ! Tu reproduis, là, le journal régional : « Si la société de consommation trouve beaucoup de satisfaction dans le libre-service, il n’en est pas moins vrai que ce procédé conduit des personnes de tout âge à se laisser tenter à commettre des larcins toujours plus regrettables. La jeune fille, prise de panique, ne regagna pas le domicile paternel mais découvrant toute la laideur de son geste, préféra se donner la mort en se jetant dans le canal du centre. » Ça leur paraissait moral, finalement, qu’elle se suicide pour un soutien-gorge.
J.T. : Et ils ont écrit ça parce qu’ils avaient un contrat publicitaire avec Mammouth. Le magasin leur avait dit : « Si vous parlez de cette histoire, on vous retire les pubs. » Voilà pourquoi ils ont fait ce texte tordu. D’autres petits journaux en avaient parlé, et ce qui m’énervait un peu, c’était que, à chaque fois, ils en faisaient une petite princesse : elle était jeune, jolie, tout ça, ils ont même hésité pour dire qu’elle était blonde... En fait non, c’était un boudin, et si ça se trouve elle était conne, mais alors ? Ça ne rend pas l’histoire moins triste. « Ah, si c’est un boudin, c’est moins grave. » Non non non, je ne voulais pas de ça.
F.R. : Il y a aussi la soucoupe volante de Jean Claude, que Mermet a fait après toi...
J.T. : Et Dechavanne, et aussi Strip Tease.
F. R. : Je lis le résumé : « Tout en me parlant de la soucoupe volante de Jean-Claude, son fils, la mère crachait dans la cuisine. A chaque fois, elle visait la poubelle. A chaque fois, elle la ratait. A un moment, elle a visé la friteuse. Manque de bol, elle l’a eue du premier coup. Il m’en a fallu de la concentration pour ne pas envoyer des fusées de partout en mangeant les frites. » Comment tu tombes sur ce Jean-Claude qui construit une soucoupe dans son jardin, et qui d’ailleurs essaie de la faire décoller ? C’est un échec mais bon...
J.T. : J’étais en reportage, en Charente, sur un mec qui était accusé d’un crime et on pensait qu’il était innocent. Beaucoup de chanteurs, Guy Bedos et tout ça avaient fait des pétitions, comme quoi ce n’était pas lui. Mais pendant ma BD reportage, j’ai la preuve que ce mec l’a vraiment butée, une prof de piano. J’appelle Gébé : « Je suis emmerdé, je sais que c’est lui. Qu’est ce que je fais ? » Il me dit : « Ah non non, putain, on n’est pas flics. Non, on ne peut pas faire ça. » Je lui réponds : « Bon bah merde alors, j’ai fait le voyage pour rien. » Et je vais dans le journal du coin, Sud Ouest : « Puisque je suis là, est-ce que vous auriez pas un dingo dans le coin ? » Un journaliste réfléchit : « Ah bah si, à trente kilomètres de là, à Archiac je crois, y a un mec qui est en train de construire une soucoupe volante en bois pour emmener sa mère mourir sur une étoile. » Formidable. Je prends !
F.R. : Y en a plein, des régals. Qu’est ce que j’ai d’autre ? Bon, l’enterrement de Gaston Defferre, c’est rare qu’on parle des ministres de cette manière-là...
J.T. : Ah ouais. A ses funérailles, tout le monde lui chiait dessus. Et moi j’ai tout balancé. Les noms, les trucs, j’en ai récolté des procès... Sept procès, tous perdus : cinq pour diffamation, deux pour injures publiques, tous paumés, alors que j’avais raison…
F.R. : L’histoire la plus terrible, je trouve, c’est celle du car.
J.T. : Oh la la ! Les emmerdements avec ça !
F.R. : Je lis la présentation. Ton titre, déjà : « Le prix d’un enfant en flammes. » Et puis : « A Crépy-en-Valois, tu demandes du feu dans la rue et aussitôt on te raconte tout sur les parents des enfants brûlés. Pas croyable ce que les parents ont acheté comme conneries avec l’argent des gosses. C’est comme s’ils avaient touché le loto du diable. Ça donne vraiment pas envie d’être chauffeur de car. »
J.T. : Après un accident de car, tragique, à Beaune, les parents ont touché une grosse somme d’argent par enfant mort. De ce fric, ils en ont fait des trucs, je me souviens plus mais des trucs de tarés complètement cinglés. Putain le bordel que ça a été !
Deux pères de famille ont déboulé rue des Trois portes, à Hara-Kiri, avec un fusil de chasse :
« Il est où Teulé ?
— Il est pas là. » Et c’était vrai. C’est Choron qui les avait reçus, qui leur avait dit : « Barrez vous sinon j’appelle les flics. » Au bout de la rue, un dessinateur d’Hara-Kiri, à un moment il sort, il était au courant de rien, et il s’est fait casser la gueule. Il me disait après : « Avec tes conneries, moi j’ai failli crever. »
Comme je savais que je te verrais, je l’ai relu hier, avant hier, je me suis dit : « Putain, c’est vachement bien. » C’était neuf. Et surtout, j’étais étonné par le culot, j’avais strictement peur de rien.
F.R. : A mon avis c’est toi, ton culot, mais c’est aussi un culot de l’époque. On vit quand même un temps où, pour la liberté d’expression, pour l’audace, tout se resserre.
J.T. : Ouais. Si j’allais voir une bonne femme, qui me paraissait une connasse, et ben, quitte à mettre une photo, je mettais la sienne, et quitte à mettre un nom, ben, je mettais le sien, puisque c’était elle, la connasse. Et à Hara Kiri, personne me disait : « Là, tu vas trop loin. » Mes sept procès, c’est toujours avec des gens plutôt riches, et Choron m’avait dit un jour : « Arrête de faire chier les riches, parce qu’ils ont toujours dans la famille un cousin avocat, ou ils connaissent quelqu’un dans le droit. Faut faire chier les pauvres, parce que rien que l’idée d’aller voir un avocat, ils sont verts. » Ce qui était un drôle de conseil.... qui était pas con techniquement, mais bon ! Et toujours Choron, il disait de moi : « Quand Teulé arrive dans une ville, les fous sortent. » Et ça m’est arrivé de faire des reportages sans sortir de la gare : j’arrivais dans une ville, je savais pas du tout ce que j’allais y foutre, à la gare un cinglé me tombait dessus…
F.R. : Est-ce que tu pourrais nous dire comment on devient Jean Teulé ? Comment on devient écrivain ? Ou artiste ? Avec ce mélange de textes, d’images...
J.T. : Quand j’étais môme, et qu’on me disait : « Qu’est-ce que tu feras comme métier quand tu seras grand ? », je répondais : « Un métier où on se lève quand on n’a plus envie de dormir. » Parce que moi, ça me cassait les couilles quand j’étais môme et que ma mère me réveillait : « Faut aller à l’école. » Je disais : « Mais j’ai pas fini mon rêve ! » Et moi, depuis maintenant très longtemps, je me lève que quand j’ai fini mon rêve. Et c’est ça, être riche.
F.R. : Mais alors, je te disais, moi, à vingt ans, à un âge où on se cherche, je tombe sur ton bouquin. Mais avant ça, toute mon adolescence, y avait Cavanna…
J.T. : Mais Cavanna ! Moi, j’aimais bien mon père, mais quand j’étais ado, quand j’avais quinze-seize ans, mon vrai père, c’était Cavanna dans ma tête. Et qu’un jour ces mecs-là m’acceptent comme collègue ! Mais je n’en revenais pas ! Et Cavanna, le nombre de fois que je lui ai dit ça ! Et d’ailleurs, le dernier livre de Cavanna, c’est à moi qu’il a demandé d’écrire la préface. Et la dernière phrase que j’ai écrite, c’est : « François, je t’aime »…
F.R. : Ça rappelle la citation de Desproges : « Tous les François sont des cons, sauf François Cavanna », et qui ajoutait : « Seule la virulence de mon hétérosexualité m’empêche de demander François Cavanna en mariage. »
J.T. : Exactement, ouais !
F.R. : Bon, alors, à quinze ans, tu es fan de Cavanna. Mais tu fais quoi ?
J.T. : J’étais au collège. Et en troisième, je suis dernier de la classe. Je vais au truc de conseil d’orientation, et comme j’étais dernier, ils me foutent en mécanique auto. Je me dis : « Putain ! Mécanique auto ! Moi j’en ai rien à foutre, des moteurs ! La vache, toute ma vie je vais me prendre de l’huile de vidange sur la gueule ! » J’arrive le lendemain à l’école, et on commençait par le cours de dessin, je faisais la tronche. Le prof de dessin, qui s’appelait Pierre Pillaud, vient me voir et me dit :
« Ben, toi qui d’habitude es joyeux, t’en fais une tête aujourd’hui ! Qu’est-ce qui t’arrive ?
— Oh putain, hier ils m’ont collé en mécanique auto.
— Mais non, t’es bon en dessin. Tu pourrais peut-être entrer dans une école de dessin. »
Je savais même pas que ça existait, moi, une école de dessin. « C’est très difficile, C’est sur concours. Y a cinq cents candidats, ils ne prennent que les cinquante premiers. Mais si tu travailles beaucoup, beaucoup, si tu prends des cours du soir, peut-être que le coup est jouable.
— Ma mère est concierge (c’était à Arcueil), mon père est ouvrier. Ils pourront pas me payer de cours du soir. Laissez tomber, je vais faire mécanique auto.
— Ben non. Moi je vais t’en donner des cours du soir. Et tes parents n’auront rien à payer. »
Et pendant trois mois, deux à trois fois par semaine, j’allais chez lui : « Dessine ta main, et la paume, et puis le bouquet de fleurs, et fais bien attention aux reflets du verre, et recommence, et recommence. » Et je fais ça. J’arrive à l’école de la rue Madame, le jour du concours. Dans la cour, je vois cinq cents mômes de mon âge. Je les regarde, je fais : « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : dehors. Lui il restera. 1, 2, 3... » et là je m’y colle et tout. Ensuite, tous les jours, j’allais ramasser le courrier, et un jour je tombe sur une enveloppe où je vois écrit « Ecole de la rue Madame ». Je déchire l’enveloppe tout doucement, je déplie, et je vois un tampon rouge au milieu du truc : « Reçu ». Là je me suis dit : « Ça y est ! Maintenant, je suis sauvé ! » Et le Pierre Pillaud, le prof de dessin, tout le temps je vais lui casser les couilles, en lui rappelant : « Sans vous, ma vie aurait été différente. » Mais deux ans après, il s’est pendu, et c’est un chagrin dont je suis encore inconsolable. Moi qui ai détesté l’école, ce prof m’a sauvé la vie.
Ensuite, j’étais copain avec la papetière d’Accueil, à côté du métro Laplace, tellement copain que souvent j’allais chez elle pour dîner, je laissais des dessins sur sa table. Un jour, un dessinateur qui s’appelait André Barbe arrive chez elle, voit mes dessins :
« Mais c’est à qui, ça ?
— Ben, c’est un de mes petits clients.
— Mais lui, il faut qu’il fasse de la bande dessinée. » C’est comme ça qu’il m’a emmené à L’Écho des Savanes, où il a obligé le directeur à m’engager. Voilà comment je me suis retrouvé à faire de la bande dessinée alors que je n’en lisais pas...
F.R. : Mon premier choc, avec toi, c’est Gens de France. Mon deuxième, ça a été Darling où tu racontes le destin...
J.T. : Oh ça c’était drôle, ouais, ouais…
F.R. : Bof… L’histoire, c’est une jeune fille qui se fait maltraiter par tout le monde, par sa famille, par son mec. Elle est humiliée, battue, et tout ça. Moi, ça m’intéressait d’un point de vue littéraro-journalistique, c’est-à-dire : comment on rend compte du réel ? Comment une personne ordinaire, on lui consacre deux cents pages ? Je trouvais ça vachement beau... Mais pourquoi tu trouves ça drôle, du coup ?
J.T. : Nan, pas l’histoire, mais comment c’est venu. Parce que Darling, c’est une cousine, une cousine germaine, le père de Darling, c’est un frère de ma mère. Ça a foutu un bordel dans la famille, ce livre ! Depuis, d’ailleurs, je n’ai plus jamais refoutu les pieds en Normandie ! Tous les cousins, les oncles m’attendent avec le fusil de chasse ! Et ce qui était drôle, c’était la rencontre avec Darling. J’étais à Canal encore, et à 11 heures et demie du matin, une fille de la réception m’appelle : « Jean, y a une femme qui vient d’arriver. Ça doit être une fermière. Elle veut pas partir d’ici avant de t’avoir raconté sa vie. Tu nous dis ce que tu veux faire parce qu’elle fout la honte dans le hall de Canal. » Je lui réponds : « Putain, une fermière qui fout la honte dans le hall de Canal ? Ça donne envie. » Je descends, je passe le portique, et je vois vraiment une grosse femme à qui il manquait des dents, avec un panier, avec des œufs, des pommes, qui fonce sur moi, qui me prend dans les bras : « Jeannot ! » Et moi je me dis : « C’est qui cette tarée ? », quoi. Et elle dit : « Mais tu te rappelles pas de moi ? Catherine, la fille de Roger.
— Ah, t’es ma cousine ? »
Je vois de Caunes et Gildas qui passent, ils croyaient que c’était un nouveau personnage des Deschiens. Elle foutait la honte dans cette boîte à petites pépettes. Comme il allait être midi, je l’invite : « Viens, on va aller déjeuner. » On va dans un resto derrière Canal. Et elle commence à me débiter ses malheurs. Et moi, à la moitié du repas, je pense : « J’arrête la télé, et je vais raconter sa vie. » Pendant qu’elle parlait, je commençais à chercher des titres, et je lui propose : « Itinéraire d’une fermière…
— Nan, nan, mais moi je l’ai, elle me réplique. Le titre, c’est Darling. »
Pourtant, quand on voit ma cousine, le premier mot qui arrive aux lèvres, c’est pas Darling, hein ! Pourquoi Darling ? Elle m’explique que c’était son nom de cibi, pour diriger des routiers perdus. A la fin du repas, comme elle est normande et moi aussi, on se prend un petit calva. Et je lui demande : « Mais comment t’es tombée sur moi ?
— C’est parce que, comme j’essayais de récupérer mes enfants, après toutes les catastrophes qu’y avait, j’ai dû aller voir une psychologue. Et la psychologue, elle m’a dit : ‘‘Ah mais votre vie, c’est un vrai roman !
— Ouais, mais moi je sais pas écrire !
— Y a un type qui travaille à la télé, il s’appelle Jean Teulé.
— Jean Teulé ? C’est mon cousin !’’ » C’est comme ça qu’elle a déboulé. Après le calva, je rentre à Canal, je file directement dans le bureau de De Greef : « J’arrête la télé. » Et lui, il sent mon haleine : « Tu me rediras ça demain, quand t’auras dessaoûlé. » Et j’y suis retourné le lendemain, à jeun, et j’ai arrêté la télé. C’est le destin d’une femme battue, maltraitée et tout. Mais elle était drôle ! Elle était rigolote !
F.R. : Après ces deux chocs, Gens de France et Darling, j’ai suivi, je pense, à peu près tout ce que t’as sorti, avec des hauts et des bas, en toute honnêteté...
J.T. : ... Ben, bien sûr !
F.R. : Comment tu deviens écrivain, d’ailleurs ?
J.T. : Ecrivain, je me souviens très bien : y a une dame qui m’appelle, que je connaissais pas du tout, Elisabeth Gilles, et qui me dit : « Je suis l’éditrice des Éditions Julliard. Ça fait des années que je vous entends à la télé. Ça fait des années que je me dis qu’en fait vous êtes un écrivain qui ne le sait pas. Venez. Je vous signe un contrat. » Bon. Et je vais la voir, j’arrive dans son bureau, elle avait préparé le contrat et un chèque. Et moi, à ce moment-là, j’avais besoin de sous. Je vois le chèque : 50 000 F. Elle me dit : « Je voudrais que vous écriviez un roman.
— Mais euh, le problème, c’est que moi j’ai jamais eu envie d’en écrire et en plus j’en lis pas. » Pis je poursuis quand même : « Bon, écrire un roman… Si c’est écrit à la main (je lui posais que des trucs techniques), c’est combien de pages ? » Elle me répond : « Ça dépend si vous écrivez petit, gros.
— Je dois écrire gros ou moyen.
— C’est deux cents pages. »
Et moi, tout d’un coup, j’avais l’impression d’être à l’école : quand je faisais une connerie, j’avais cent lignes à faire. Alors deux cents pages, putain...
Et puis, vraiment, le chèque m’intéressait, donc j’ai signé le contrat, j’ai pris le métro pour rentrer chez moi et je me suis dit : « Mais je suis con ! Maintenant faut que j’écrive un livre ! » Et j’ai failli faire demi tour. Finalement voilà, je suis rentré dans l’édition par avidité, quoi, par cupidité.
F.R. : C’était quoi, le roman ?
J.T. : Rainbow pour Rimbaud.
FR. : Ouais, c’est le premier dans ta série des poètes, parce qu’après Rimbaud, tu as fait Verlaine, que j’ai beaucoup aimé. Et aussi Villon, qui pour moi est un chef-d’œuvre. Jamais j’ai vu de pire salaud que Villon !
J.T. : Ben ouais.
F.R. : Y a une scène, quand il fait enfermer son amante...
J.T. : Quand il la fait violer d’abord... violer par quarante Coquillards, qui étaient les pires bandits de l’époque. Et lui voulait rentrer dans la confrérie des Coquillards, mais y avait un prix d’entrée : il fallait commettre un meurtre devant témoins, un meurtre sans raison, et après il fallait faire un cadeau aux Coquillards. Et les Coquillards lui ont dit : « Tu veux faire partie de notre confrérie ? Tu nous amènes ta femme. » Et n’importe quelle gonzesse qui se fait violer par un mec, c’est terrible. Mais se faire violer par quarante Coquillards... Et là, cette femme, Isabelle, après, elle s’est fait enfermer au cimetière des Innocents à Paris. Les gens pensent que j’ai inventé ça, mais ça existait vraiment : des loges de recluses... toujours des femmes, évidemment, volontaires, et pour des chagrins d’amour, elles entrent dans une petite cabane en pierres d’un mètre carré, où il y a un banc, des toutes petites fenêtres avec des barreaux, et seulement trois murs. Une fois qu’elles y rentrent, on maçonne le quatrième mur, et elles y restent à vie. On glissait leurs repas entre les barreaux, pour qu’elles puissent un peu bouffer, leurs ongles poussaient, leurs cheveux, elles se chiaient dessus... Très souvent, les femmes me disent : « En lisant Je, François Villon, à un moment j’ai arrêté », je sais exactement à quel moment.
F.R. : C’est sûr, moi j’ai jamais vu un pire salopard !
J.T. : Quant à moi, c’est ma compagne qui un jour m’a dit : « Allez, viens, on va aller voir un film, Merci Patron ! » Elle me raconte le scénario, je fais : « Oh la, t’es sûre ? »
F.R. : Un truc de gauche, chiant, sur les ouvriers, quoi ?
J.T. : On a été mais accrochés, bluffés par ça ! Et rétrospectivement, je me disais, y avait un cousinage entre nous...
F.R. : J’espère, oui, avec Cavanna comme grand-père…