Un monde est mort, il court encore... La preuve par le poulet (3)
par 18/01/2013 paru dans le Fakir n°(57 ) septembre - novembre 2012
On a besoin de vous
Le journal fakir est un journal papier, en vente dans tous les bons kiosques près de chez vous. Il ne peut réaliser des reportages que parce qu’il est acheté ou parce qu’on y est abonné !
Ce sont les penseurs de l’aviculture. Un institut où se fabrique le discours productiviste de la filière.
Et quand une crise survient, ses propositions deviennent des solutions…
[*Les intellectuels de la volaille*]
« Vous êtes un peu le think tank de la volaille ?
Disons qu’on est un lieu de concertation. On a un rôle d’animateurs, qui associons chercheurs, syndicats d’éleveurs, industriels… »
Pascale Magdelaine est « experte permanente » à l’Itavi, l’Institut technique d’aviculture. En liaison avec l’Inra, la FDSEA, Doux, etc, cet organisme met ses « compétences au service des éleveurs et de l’industrie » – comme l’indique son slogan (en anglais).

[*Horizon [*2025*]
*]
Pour son rapport « Prospective : la filière avicole à l’horizon 2025 », furent ainsi auditionnés des cadres du Crédit agricole, des responsables de la grande distribution, des économistes, des hauts fonctionnaires... Pour aboutir à ce constat : « La taille moyenne des ateliers français est de 17 000 animaux, alors que dans les autres pays européens, l’effectif moyen dépasse aisément 30 000 têtes, pour atteindre un maximum au Royaume-Uni de près de 94 000 têtes. »
D’où cette recommandation, réitérée dans (presque) chaque intervention :
« À l’avenir, la spécialisation des exploitations et un agrandissement de la taille des ateliers apparaissent comme un moyen d’améliorer la compétitivité des élevages français. Le modèle idéal pour certains industriels serait celui de complexes permettant une optimisation logistique de la collecte, constitués de grosses unités d’élevage (4 000 mètres carrés de bâtiments), professionnelles et sécurisées, situées dans un rayon maximum de 50 à 70 kilomètres autour de l’abattoir. »
Jusqu’à bâtir le consensus :
« L’ensemble des avis converge vers la nécessité d’une modernisation et d’une augmentation de la taille des élevages. »
Avec un modèle qui revient, constamment : « Notre degré de concentration est plus faible que celui observé dans les secteurs avicoles d’autres pays comme l’Allemagne… »
[*Les perroquets de l’Itavi*]
Quelle importance, me répliquera-t-on, que ce laboratoire inconnu ?
À quoi bon lui consacrer une page ?
Parce que ce sont les véritables penseurs de la filière. Qui ne se contentent pas de réfléchir dans une tour d’ivoire : par des salons, des newsletters, des colloques, leurs idées se diffusent dans les séminaires d’entreprise, dans les tables rondes syndicales, jusqu’aux cabinets ministériels.
Quand Didier Goubil (voir partie précédente) parle de « concentrer davantage », qu’ « on est 10% plus cher que les Allemands », qu’ « il faut des plus grosses exploitations », j’entends derrière la voix de l’Itavi. Idem lorsque Jacques Jaouen, le président de la Chambre d’agriculture du Finistère, s’exprime dans Ouest-France : « Pour que la Bretagne redevienne leader dans ses productions, il s’agit simplement de laisser l’entrepreneur investir, en adaptant la réglementation des ZES [zones excédentaires en azote à cause des rejets d’élevages] pour permettre les agrandissements… En redensifiant la production, le prix de la viande sortie abattoir serait plus proche du prix allemand, un de plus compétitifs en Europe » (4/7/12).
Ce discours, c’est à l’Itavi qu’il a largement été fabriqué.
Son diagnostic sert de base aux grandes orientations. Et ce, d’autant plus que les contestataires, en face, ne disposent pas des mêmes armes, ne s’appliquent pas au même travail – ni d’analyse, ni de rencontre, ni de restitution. Ce champ intellectuel, l’aviculture, est laissé libre à cet institut, militant du productivisme. Quand une crise survient, tel le choc Doux, ses propositions deviennent des solutions. Car oui, pour l’instant, on s’oriente bien, massivement, vers le « modèle allemand »… Avec un peu de bio à côté, pour la déco.

[*Deux obstacles : libre-échange et cordon bleu*]
L’Itavi, voilà des adversaires idéologiques. C’est dans leurs documents, néanmoins, qu’on trouvera la plus grande richesse de données, de statistiques. Pour repérer les obstacles sérieux, objectifs, à une reconversion de la filière, il nous faut donc partir de leur état des lieux.
Le premier obstacle, c’est le libre-échange.
« Il y a près de vingt ans, écrivent ces « experts », à l’occasion de la mise en place des accords de Marrakech, de nombreux travaux ont montré que le handicap principal de l’Europe vis-à-vis de l’Amérique du Sud résidait dans une main d’œuvre beaucoup plus coûteuse. »
D’après Pascale Magdelaine, l’une des expertes de l’Itavi, « il y a un écart de 30 à 35% à l’égard du Brésil. Ce qui est quand même énorme. Grosso modo, la moitié du déficit de compétitivité est dû au coût du travail, un quart aux normes environnementales, et le dernier quart aux aliments plus chers ». Et pour aggraver la distorsion, lorsque l’Europe édicte une modeste réglementation, elle ne « s’applique pas aux pays tiers ».
Cette difficulté, Fakir l’a – depuis longtemps – surmontée sans trembler : il faut du protectionnisme. Aucun progrès, social, fiscal, environnemental, n’est pensable en économie ouverte.
C’est un scénario envisagé par l’Itavi. Mais voilà qui paraît bien improbable à ces chercheurs : au contraire, l’Union européenne pèse à l’OMC pour « une conclusion ambitieuse du cycle de Doha ». Et Pascale Magdelaine de préciser : « L’Europe souhaite la prise en compte du bien-être animal, mais ça reste un vœu pieux. Elle ne cherche pas à défendre le marché intérieur, alors que les États-Unis n’importent pas un gramme de volaille. »
Député européen, José Bové espère encore, au téléphone : « Nous, on se bagarre pour des règles internes à l’Europe, qui soient également valables pour les importations…
- Donc, on conclut, vous réclamez du protectionnisme ?
- Non, c’est pas une forme de protectionnisme, c’est plutôt… (Rires dans le combiné.) Une défense de la souveraineté alimentaire. »
Le second souci, c’est la structure du marché.
Cernés par les militants, on est immergés, parfois, dans des milieux où l’un adhère à une Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap), l’autre bouffe bio, un troisième plante ses salades, etc. Voilà qui crée une illusion d’optique, entretenue par des médias prompts à vanter ces « nouveaux modes de consommation éthique ».
Mais la réalité s’avère bien éloignée : 85 % des achats de volaille se font en supermarché. Et le bio représente moins de 1% des abattages de poulet. Le labellisé, seulement 15 %. Plus inquiétant : cette proportion, loin de croître, diminue lentement. Pour quelles raisons ?
Conjoncturelle, d’abord, à cause de la crise économique. Dans les « raisons d’acheter un produit », d’après les enquêtes en 2000 du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc), « le produit porte un label de qualité » devançait légèrement « le prix est compétitif » : 73% contre 72%. En 2008, la donne est bouleversée : le critère « de qualité » plonge à 58 %, contre « le prix » qui grimpe à 79 %. Depuis, le mouvement ne fait que se confirmer.
Il existe une cause structurelle, ensuite. Sur le « poulet entier », le « label rouge » résiste bien, avec près de la moitié des ventes : là, pour faire cuire sa volaille à la broche, le consommateur veille à la qualité. Mais justement, ce marché décline. Alors que la « découpe » (les cuisses seulement, ou les ailes) et les « produits transformés » (escalope panée, cordons bleus) s’étendent. Et sur ces segments-là, le label est largué : « Quand on mange des nuggets, résume Pascale Magdelaine, on ne pense même plus au poulet derrière. La mère de famille pressée ne va pas faire attention au label. »
Cet obstacle, sans doute peut-on le surmonter, par des lois, par des incitations, par des subventions, par des interdictions, bref, par une volonté politique, avec un plan dans la durée. Mais on doit l’affronter. S’y confronter. Ne pas le balayer d’un revers de « nous, on a des alternatives, mais évidemment les agriculteurs n’en veulent pas ». Proclamer que la « filière peut se convertir facilement », c’est illusoire pour les producteurs et les salariés. Qui, d’ailleurs, ne se laissent guère prendre à cette illusion…


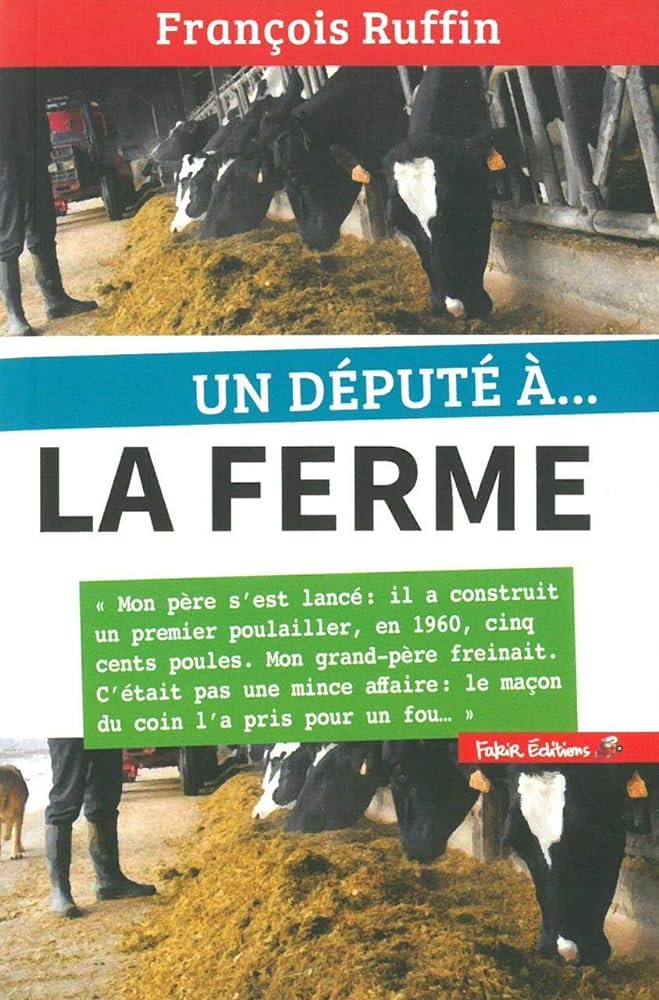





Messages
19 janvier 2013, 05:35, par restifdelabretonne
Des crétins déshumanisant que je verrai bien, la tête en moins, courir après leur gain... Un jour sans doute !