Crête d’un jour...
par 31/03/2017 paru dans le Fakir n°(55) mai - juillet 2012

On a besoin de vous
Le journal fakir est un journal papier, en vente dans tous les bons kiosques près de chez vous. Il ne peut réaliser des reportages que parce qu’il est acheté ou parce qu’on y est abonné !
Plutôt que l’hôpital psychiatrique du coin, c’est Gabrielle qui m’a recueilli, en Bretagne. Je suis reparti à Paris escorté par un chien et un mec en cavale, des dessins et des textes sous le bras, avec une chouette crête de punk…
[**Y’avait rien à faire,*] je foutais la merde partout où je passais. Qu’est-ce que j’avais bordel de dieu ? J’étais gentil pourtant ! Je faisais attention ! Hein ! Respectueux serviable ! Et de l’allure ! Mais ça fâchait tout le monde mes histoires, ça finissait tout le temps dans des torrents. Encore tout à l’heure au resto avec mon pote et sa meuf, en pleine Bretagne, ça s’était envolé furieusement. Je m’étais tiré de chez eux alors, pour plus emmerder personne. J’avais fini dans un rade à m’envoyer des calvas de tristesse. Le type fermait maintenant, j’étais le dernier client, y avait plein de givre sur les bagnoles et je voulais pas dormir dehors une fois encore.
« Il y a un hôpital psychiatrique, dans le coin ?, j’ai demandé.
— Pardon ?
— Je disais, vous avez un hôpital psychiatrique, dans la région ? »
Le mec a fait tomber toutes ses fléchettes. « Oui oui, il y en a un.
— C’est loin ?
— Ben faut prendre la rocade, ça fait quand même quelques kilomètres. »
J’y aurais bien dormi, je sentais que par moments j’avais des trucs qui déconnaient. « Parce que sinon, maintenant, il n’y a plus rien d’ouvert ?
— Ouvert ? A deux heures du matin ? Attendez voir… Si, peut-être le Coyote, c’est une boîte de nuit, tout au fond de la rue. »
[**Ce qui m’a stupéfait,*] c’est qu’au Coyote, ils m’ont laissé rentrer.
Dedans tout le monde fumait, on n’y voyait que dalle et j’avais plus un rond. J’ai quand même demandé un calva. On me l’a servi, je me suis allumé une clope ravi. C’était du brutal, ici, du rustique alors bien solide. Du gaillard en survêt de foot, du prolo aux mains de cambouis, du mec qui dansait avec ses chaussures de sécurité – ça me plaisait. On se la racontait pas, au Coyote, on buvait de la Stella et toutes les filles étaient en baskets. Moi je dépareillais presque pas, sauf avec mon calva, d’ailleurs un jeune type m’a demandé s’il pouvait goûter et il a toussé en disant que c’était vachement fort. Il m’a filé un grand coup de bière, et il m’a demandé si j’avais vu les deux gonzesses, là-bas. Non ? Viens ! Il m’a présenté ses deux cousins, et Gabrielle et Pauline. De la gouine hein c’est une Pauline !, il rigolait, Sébastien. J’entendais pas très bien avec la musique. « Elles sont gouines !, il m’a crié en plein dans l’oreille.
— Ah bon ?
— Ouais ! Elles se roulent des pelles ! »
Il avait l’air très content. C’est vrai qu’elles se roulaient un tas de pelles, toutes les deux, et elles se touchaient un peu les seins ça déchaînait tous les cousins. Moi je suis retourné au bar et j’avais l’obsession de Gabrielle. C’étaient ses yeux, surtout, un mélange andalou, ça sentait flamenco et ça me foutait la passion. Elle m’a repéré Gabrielle à loucher dans mon calva et elle est venue vers moi. « T’arrêtes de me mater comme ça ?
— Je suis désolé, je…
— Tu vois pas que je suis avec ma copine ?
— Pardon, je voulais pas…
— Viens ! »
[**Elle m’a pris par la main*] jusqu’au milieu de la piste, et on s’est mis à danser une sorte de slow un peu décalé puisque c’était de la techno qui passait. « Pourquoi tu me mates ?
— Ben je…
— Tu sais, c’est pas ma meuf, Pauline, c’est ma meilleure amie. On s’est mises à s’embrasser parce que les trois mecs nous emmerdaient. T’es d’ici ? Je t’avais jamais vu.
— Non, je suis d’Ardèche, je suis venu voir un pote… Mais je viens de me barrer de chez lui.
— Tu dors où ?
— Je sais pas…
— Tu veux venir à la maison ? Je t’avertis, y a nos mecs, à Pauline et moi, et mes deux filles. Ce soir, c’est exceptionnel, j’ai laissé les petites à mon homme, on a dit c’est soirée meufs, on s’éclate, parce que le reste du temps, c’est pas la joie. »
On s’est installés au comptoir.
Elle avait pas connu ses vieux, Gabrielle, juste les foyers et les familles d’accueil. Elle avait pas tellement fait d’études non plus, et à partir de 16 ou 17 ans, elle s’était mise à courir « les teufs ». A faire que ça pendant des années, de raves en frees, de Bretagne en Hollande, de murs de son en petits amplis, avec un tas de produits qu’elle s’envoyait de tous les côtés. Elle avait beaucoup de mecs en même temps, et puis y avait eu Julien. Jul’ était punk bien carrément, avec des chaînes et plein de chiens, et c’était lui qui avait tatoué un large « no future » sur l’épaule de Gabi qu’elle me montrait maintenant.
« T’as vu, il est joli, non ?
— Oui…
— C’est tout ce qui me reste de lui. »
Gabrielle était tombée enceinte, un soir de caravane et de basses à plein tube, elle avait 23 ans et Julien était vachement content : c’étaient des jumelles. Mais il les avait jamais connues, Julien. Avant l’accouchement, il avait fait une gigantesque montée d’acide, et il en était jamais revenu. Il était resté perché, tout en haut des paradis artificiels, bien enfermé dans un hosto depuis maintenant six ans. Il ne reconnaissait plus rien ni personne avec ses yeux bleus révulsés à jamais par la came. Au début Gabrielle allait le voir, entre ses murs de béton. Et puis elle en avait fait son deuil, jusqu’à croire elle-même l’histoire qu’elle racontait à ses filles : papa a eu un accident de voiture deux jours après votre naissance. Il vous aimait beaucoup.
[**Un sacré merdier,*] à élever, les jumelles, toutes les trois dans un camion. Pas d’eau courante, étouffer l’été, se les geler l’hiver… La musique qui finit par taper sur le système de la mère… Et tous les drogués de la terre… Il avait fallu se calmer… Plaquer les frees et la vie arrachée, les services sociaux commençaient à insister… Ils lui avaient pourri l’enfance, fallait qu’ils la poursuivent adulte, les connards de la Ddass… Ils lui avaient trouvé un logement social. Et elle s’était mise à bosser, Gabrielle, la punk, la révoltée, avec toutes ses boucles dans le nez. A faire la plonge à Macdo, à nettoyer dans les restos, à laver le linge dans les hostos. Mais ça durait jamais trop, tous ces boulots. On finissait à chaque fois par la dégager. Même les HLM l’avaient foutue dehors, trop de mois qu’elle payait plus son loyer. Elle vivait maintenant chez Pauline, au fin fond de la forêt, dans une baraque qu’un vieux paysan louait, mais c’était la sarabande des huissiers : pas de tunes à refiler. Punk un jour, punk toujours : on s’en foutait !
Pauline a rappliqué, on avait tous vachement picolé, mais personne n’avait de quoi raquer. On s’est tiré vite fait, et elles m’ont embarqué en bagnole. Y avait dix bornes jusqu’à la forêt.
[**« Ta gueule, Chirac !,*] on a gueulé derrière la porte.
— C’est Bertrand, le mec de Pauline. Ce con de chien l’a réveillé », m’a expliqué Gabrielle.
On est rentrés.
C’était un fantastique bordel, à l’intérieur, une espèce de dépotoir aménagé, et Chirac m’a immédiatement tout dégueulassé. « Bertrand mon amour, c’est Pierre. Il était à la rue, on lui a dit de venir.
— A la rue, lui ? Mon cul ! », a dit Bertrand.
Il avait une fameuse crête et il devait faire deux mètres.
« Je me casse, si tu veux, je veux pas déranger, j’ai répondu.
— Mes couilles ! C’est un bourgeois !
— Je vais y aller…
— Tu veux aller où, à quatre du mat, connard ? T’inquiète poète, je déconne. Viens, on va se faire une bière. »
Ça faisait trois jours que j’avais pas dormi, et j’ai senti qu’avec Bertrand j’allais pas me reposer tout de suite. « Qu’est-ce qui t’arrive, alors, petit ? T’as des soucis ? Papa maman t’ont coupé le robinet ? Ils te filent que 2 000 euros par mois ? Tu t’en sors plus ? »
Ça commençait à me gonfler, ses remarques, alors c’est monté d’un coup. Je lui ai tout craché à la gueule à Bertrand, bien violemment, mon passé avec ses haches ses flics ses camisoles, en expliquant que là je savais plus où je créchais et qu’il fallait arrêter de me les casser.
« T’emballe pas poète, tu reprends une bière ? »
[**On a trinqué à la Fritz braü.*]
Bertrand aussi avait de belles emmerdes. Y a deux mois, il s’était complètement défoncé aux ecstas avec un pote. Ils avaient pris la bagnole, ils étaient tombés sur les flics à un péage et ils étaient passés quand même plein pot en renversant un agent. Depuis son pote s’était fait gauler, il était en préventive, et Bertrand était en cavale. S’ils le chopaient, il allait en prendre plein la gueule, vu qu’il avait un casier comme ça et du sursis qui allait tomber pour de vieilles histoires. Mais il s’en tapait complètement, lui l’ancien docker, puis marin pêcheur trop bagarreur viré par tous ses patrons successifs. « Ils étaient fachos, faut pas gonfler un punk avec Jean-Marie. La jeunesse emmerde le Front national ! » Il bossait plus depuis longtemps, du coup, Bertrand. Du RMI par ci, vider une ou deux baraques par là, faire un peu de black, assez pour bouffer et les petits plaisirs. Il a roulé un pétard et il s’est fait pensif, en me disant que c’était plus le bon temps comme avec Toulouse.
« T’es resté longtemps, à Toulouse ?
— Pas à Toulouse, poète, avec Toulouse. Toulouse-Lautrec, ça te dit un truc ?
— Un… Le peintre ?
— T’es allé à l’école, toi poète, ça se voit. Ben moi je vais te dire, quand j’avais vingt piges, j’ai rencontré son arrière-petit-neveu. Le meilleur pote que j’ai jamais eu. Il s’appelait lui aussi Toulouse-Lautrec, mais on disait ‘Toulouse’. J’étais dans un bar un soir à Paname, affalé sur ma table, complètement cuit, et j’ai redemandé un whisky. Le serveur a refusé : ‘Maintenant, c’est dehors !’ Alors un type au comptoir a dit : ‘Servez-lui un double.’ L’autre a répondu ‘bien sûr monsieur Toulouse’. Il m’a servi mon double, j’étais rétamé. Toulouse m’a invité à dormir chez lui, on s’est plus quittés. »
Avec Toulouse, Bertrand avait mené la grande vie. Il habitait dans son immense appart huppé, où Toulouse peignait, buvait, écrivait, se droguait, invitait un tas de paumés. Quand y en avait trop à la maison, Bertrand et lui se tiraient. Ils allaient dormir dans des palais, suites de grands hôtels payées d’entrée qu’ils dévastaient – ils s’en foutaient : Toulouse avait une tune infernale. Pour éviter de draguer, parce que Toulouse disait que ça le fatiguait, ils se payaient plein de filles de luxe aussi, à grands coups de magnums de Veuve-Clicquot. « Plus fort que les punks, Toulouse, me disait Bertrand. Il emmerdait le monde entier. »
[**
« Dis Pauline, tu trouves pas qu’il a une sale gueule, le poète ?,*] a lancé Bertrand.
— Ben non, mon amour…
— T’es chez les punks poète, faut que tu t’y mettes ! On va te refaire ta gueule ! Pauline ! Amène les ciseaux ! Tu lui fais la totale !
— Qu’est-ce qui se passe ?, j’ai demandé.
— La même coupe que moi ! Va te mouiller les cheveux ! »
Je suis passé à la salle de bains, puis Pauline m’a installé torse poil sur une chaise au milieu du salon. Le jour se levait, les jumelles ont débarqué.
Bertrand m’a présenté, « Pierre, ex-poète, futur punk », les petites buvaient leur Chocapic et elles rigolaient bien en voyant mes cheveux tomber. Elles étaient magnifiques, deux princesses des caravanes.
Au bout d’une demi-heure, Pauline m’a amené un miroir et une bière en me demandant si ça allait. C’était parfaitement détonant. J’avais une barbe de trois semaines, les joues creuses, les yeux complètement cernés, et des crêtes qui partaient de tous les côtés avec de gros trous dans la tête. J’étais très satisfait.
Bertrand m’a fait du café avec plein de rhum dedans, et il m’a battu aux échecs. Nico, qui venait d’arriver, a voulu faire une revanche. C’était la fragilité incarnée, Nico, avec des yeux très loin perdus au fond des orbites, et des mains toutes pâles qui tremblaient sans arrêt. Il sortait juste de cure de désintox, c’était tellement dur de se passer de l’héroïne, il m’a raconté d’une voix très douce. J’avais l’impression que si je lui soufflais un peu dessus, il allait s’effondrer.
[**J’avais pas tellement dormi,*] finalement, et j’étais complètement bourré. Fallait pourtant que je prenne le train pour Paris, j’avais rendez-vous chez le psychiatre le soir même. « T’inquiète, on va t’amener à la gare », m’a dit Bertrand. Pauline m’a offert quelques dessins qu’elle avait faits. Ils étaient très beaux, je trouvais, c’étaient partout des gens en train de baiser : « Bertrand et moi. » Elle m’a offert un texte, aussi, calligraphié.
« Extrait de mon exubérante excentricité : expressive, je m’exprime avec extravagance.
Expédiée en exil, exclue, exemptée de m’exclamer… J’expire…
Exhumée, exhortée, exactement j’existe exaspérée d’être expatriée – j’exagère.
Mais exquise, excessive, j’esquive l’explosion expédiée en exode exotique express.
J’excuse, j’exhale, explicite je m’exit.
J’examine l’excroissance exaltante en exposition, exhibée, excitée, j’exauce et j’exerce les exigences de l’extrême excès.
Extra expansive, j’explose… L’extase ! »
J’ai fourgué le texte et les dessins dans mon sac.
Les jumelles voulaient pas que je parte, elles me trouvaient vachement marrant avec ma nouvelle tête.
[**Je leur ai demandé*] de me laisser devant la gare, de pas s’emmerder : « Non non, on t’accompagne ! » Le TGV partait dans cinq minutes, j’avais pas d’argent pour un billet. « Au pire, ils te foutent dehors à Rennes, et tu prends le train d’après », m’a conseillé Bertrand. Sur le quai, il m’a demandé bien fort de regarder ces gros pédés. C’étaient deux contrôleurs chauves qui nous regardaient l’air ahuri, Nico, un énorme pétard à la bouche, Bertrand et son pote Florent avec leurs crêtes et leurs chaînes, Chirac qui aboyait plein pot, et les bières qu’on faisait tourner. Bertrand leur a demandé s’ils avaient un problème. Les contrôleurs ont dit que non, ça allait. Alors il en a pris un par l’épaule : « Je vais t’expliquer un truc. Mon pote Pierre, là, il a pas de billet. Parce qu’il a pas une tune et qu’il est en galère. Mais tu vas pas le faire chier, ok ? Tu vas pas l’emmerder avec tes prunes débiles. Il a rendez-vous chez son médecin à Paris, alors tu lui fous la paix. T’as compris ?
— Oui oui monsieur, écoutez, le train va partir…
— Lui aussi, tu le laisses partir. Parce qu’on y tient. »
On s’est embrassés.
J’ai dormi jusqu’à Paris.


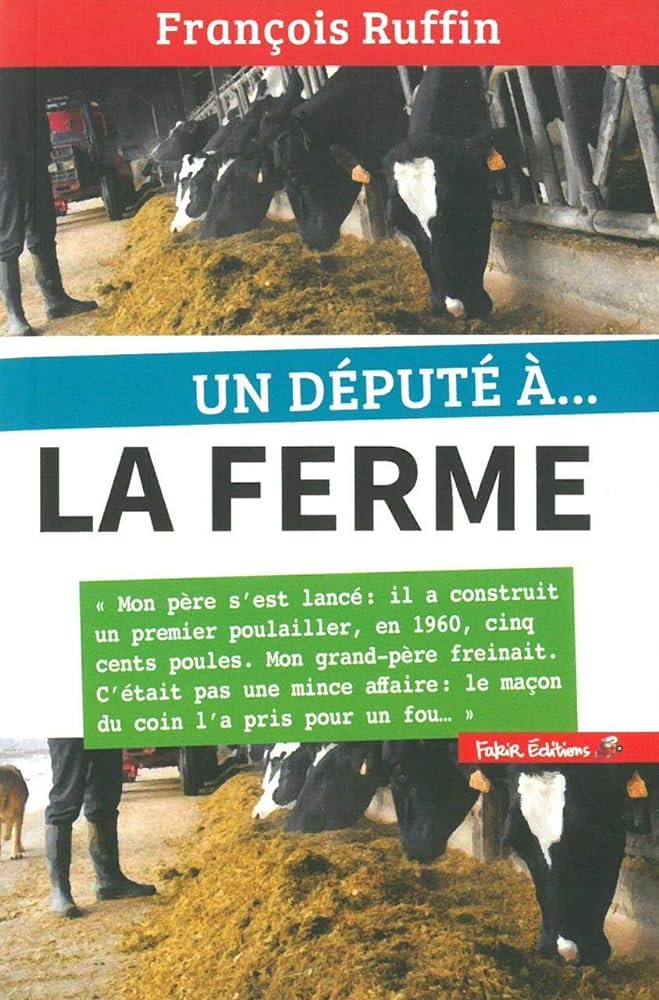





Messages
31 mars 2017, 14:17, par artus
Super article :)
31 mars 2017, 16:27, par Horror
C’est très beau.
31 mars 2017, 16:49, par Horror
C’est très beau.
2 avril 2017, 10:02, par BrianDuSysCat
c’est l’histoire d’un type qui se fache même avec ses amis et dort dans les HP. En même temps il va au resto et boit dans les bars.
Alors vu qu’on l’imagine mal garder un emploi plus de 2 heures, on se demande d’où vient le pognon, car effectivement quand on est au RSA on a du mal à même se payer même un expresso. Papa/maman ? Ou alors il deale de temps en temps ? C’est comme si on racontait qu’un objet lévite dans une pièce sans donner plus de détails.
Si pour l’auteur il semble inutile d’expliquer comment on peut être anarchiste punk et manger et boire au resto, perso je me pose la question.
5 avril 2017, 16:00, par LANVIN
Ouais, je vois pas ce qu’y a d’intéressant dans cette histoire .
Des paumées qui s’enfoncent dans l’alcool, la drogue etc..
Bref, de futurs clochards.
En plus, ils font des gosses.
Pauvres enfants.