Le surgissement du réel
par , 11/11/2016 paru dans le Fakir n°(76) juillet-août 2016

On a besoin de vous
Le journal fakir est un journal papier, en vente dans tous les bons kiosques près de chez vous. Il ne peut réaliser des reportages que parce qu’il est acheté ou parce qu’on y est abonné !
On est abreuvés d’infos, on communique dans tous les sens, mais dedans, si peu de réel. Et même dans la littérature. Qu’une tranche surgisse, et c’est comme une pépite.
Ainsi des « On vaut mieux que ça ! » dans les médias.
Et des Tribulations d’un précaire au rayon littéraire…
« En ce moment même, les résidents habitent une caverne noyée de fuel et Charlie a autre chose sur les bras qu’un âne sans tête. »
Faudrait pas qu’on l’oublie : tout ce bazar autour de la loi El Khomri a commencé, en février, avec les témoignages d’ « On vaut mieux que ça ! ».

Ça les stupéfiait, les médias, que des jeunes narrent leurs histoires de taf face webcam. Tout comme ça leur coupe le souffle, à mes spectateurs, quand Jocelyne et Serge Klur annoncent qu’ils manquent d’essence pour la voiture, que leur maison n’est pas chauffée, qu’ils ne mangent pas tous les jours, et autres joies de la pauvreté.
Ça sciait tout le monde.
Et c’est le plus surprenant, peut-être, cette surprise. On est abreuvés d’infos, on communique dans tous les sens, et que je te tweete et retwette le dernier édito, mais dedans, si peu de réel.
Qu’une tranche surgisse, et c’est comme une pépite.
Elle brille, elle déconcerte.
Et surtout, on la commente.
Y a une mission du journaliste, rarement remplie, que de nous dévoiler ce réel : pour une Florence Aubenas et son magnifique Quai de Ouistreham, combien d’autres qui se précipitent là où se trouvent déjà trente caméras, cinquante micros, deux cents stylos ?
Mais c’est une mission de l’art, également, de la littérature, du cinéma, de la chanson pourquoi pas, que de nous offrir un regard sur ce réel, y ajoutant une intériorité, une interprétation. Quel bouquin, je me demandais, serait le pendant épique des « On vaut mieux que ça ! », racontant une jeunesse contemporaine et ses mille petits boulots ?
J’ai pensé à Antoine.
Le dernier roman qu’il m’a remis, avant son décès, dûment corné et annoté, c’était Les Tribulations d’un précaire, de Iain Levison.
Je m’étais bien marré, devant les embrouilles de l’antihéros : « Au cours des dix dernières années, j’ai eu quarante-deux emplois dans dix États différents. J’en ai laissé tomber trente, on m’a viré de neuf, quant aux trois autres, ç’a été un peu confus. (…) Sans m’en rendre compte, je suis devenu un travailleur itinérant, une version moderne du Tom Joad des Raisins de la colère. À deux différences près. Si vous demandiez à Tom Joad de quoi il vivait, il vous répondait : “Je suis ouvrier agricole.” Moi, je n’en sais rien. L’autre différence, c’est que Tom Joad n’avait pas fichu quarante mille dollars en l’air pour obtenir une licence de lettres. »
Parmi ses « quarante-deux emplois » :
Je trouve un boulot de livreur de fuel.
Le salaire est de huit dollars de l’heure, mais ce qui est bien c’est qu’une fois que j’ai rempli le camion-citerne le matin je n’ai pas à revoir mon supérieur jusqu’au moment où je lui remets mes reçus en fin de journée. J’ai un émetteur radio dans le camion et on peut m’appeler de temps en temps pour me demander où je suis, pour savoir si je respecte mes horaires. Mais bon, les horaires ne sont pas très chargés.
La difficulté c’est d’apprendre le parcours. Je fais la Main Line de Philadelphie, encore une fois au service des riches, dont beaucoup ont des résidences somptueuses. Des familles de trois ou quatre personnes habitent dans des châteaux de dix-huit chambres, avec des voitures de sport neuves dans toutes les allées. Je circule en me demandant comment ces gens-là gagnent leur vie. D’où viennent les riches ? Est-ce que les propriétaires de toutes ces maisons sont des génies, des inventeurs de moteurs de fusées et de traitements des maladies ? Ils ont eu une grande idée, comme les Post-it, et l’ont capitalisée ? Cet énorme surplus d’argent cache-t-il des histoires passionnantes, ou le simple héritage d’une usine qui fabrique des coupe-ongles de pied pour l’armée ?
Une chose est sûre, ils pensent le mériter. Je ne connais pas beaucoup de gens riches, mais j’en ai croisé suffisamment pour savoir que même ceux qui vivent de leurs rentes considèrent qu’ils sont spéciaux, pas qu’ils ont eu de la chance. Ils réinventent le passé et incluent des détails sur leur patience et leur courage, à l’intention de celui qui les écoute, et il y aura toujours quelqu’un pour le faire parce qu’ils sont riches. C’est toujours plus marrant d’écouter les riches parce qu’il peut y avoir une chance d’être invité à les accompagner aux Bahamas ou qu’ils vous prêtent une voiture de sport pour le week-end. Il m’a fallu un certain temps pour comprendre qu’ils sont d’habitude plus radins que les gens que je fréquente.
[…]
Le plus compliqué, c’est de savoir où se trouve la cuve de fuel de chaque maison. Chaque bon de livraison comporte un petit schéma, mais l’entrée de la cuve se présente sous la forme d’un tuyau métallique d’environ dix centimètres de diamètre, et il est souvent caché derrière des buissons, sous des pierres, ou complètement enfoui sous la neige. […] A une adresse, le schéma est remplacé par une note qui dit simplement « Remplissage sous le nez de l’âne ». Je m’arrête dans l’allée et je vois une immense statue d’âne devant la maison, je m’approche et j’examine son museau. Je décide que l’âne doit être le réservoir de fuel. Ses narines de ciment sont assez grandes pour recevoir mon tuyau, même si je ne vois pas de filetage dans lequel visser l’embout. Je l’enfonce aussi loin que possible dans la narine et j’ouvre l’arrivée à fond.
La tête de l’âne explose et je suis inondé par une pluie de fuel et de ciment. Aveuglé, je cherche à tâtons mon tuyau qui a des convulsions d’anaconda épileptique et lance du fuel dans tout ce joli paysage. Après avoir pris au moins trois fois dans la gueule une giclée de trois cents litres à la minute, je réussis à plaquer le tuyau au sol et à le fermer, non sans avoir bu la tasse. J’étouffe, je suis trempé, je retourne tant bien que mal au camion et j’appelle le bureau par radio.« Je suis au 1105 Chester Springs. Leur cuve vient de péter.
- Comment ça, elle vient de péter ? »
Charlie, qui coordonne les livraisons, a été lui-même livreur pendant quinze ans. Il connaît par cœur chaque adresse.
« Elle vient de m’exploser dessus.
- C’est celle à côté de l’âne, c’est ça ? »
A côté de l’âne ? Qu’est-ce qu’il veut dire ?
« Oui », je réponds avec prudence.
« J’envoie quelqu’un. »Je cours vers l’âne sans tête et inondé de fuel. Je gratte comme un fou le sol sous le nez de l’âne et ma main heurte du métal sous la neige. Je repousse la neige et là, qui se marre, le bouchon de la cuve.
J’explique que « sous le nez de l’âne » était ambigu. Je suis dans le bureau de Charlie, mais il veut que je m’en aille. Tout le monde veut me voir partir parce que je suis trempé de fuel et qu’ils étouffent.
Charlie a de l’expérience. Il ne va pas me virer parce que qu’il a déjà vu ce genre de choses, et aussi parce que je ne suis pas l’employé le plus stupide qui ait travaillé pour lui aujourd’hui. Cet honneur revient à un autre gars qui s’appelle Dave. Il a rempli une fosse septique de plus de deux mille litres jusqu’à ce que le fuel ressorte par les cuvettes des toilettes et inonde les salles de bains d’une maison à un million de dollars à Kimberton. Ensuite, en sortant de la propriété, il est entré dans un poteau et a coupé le courant. En ce moment même, les résidents habitent une caverne noyée de fuel et Charlie a autre chose sur les bras qu’un âne sans tête.
« Dehors, me dit-il. A demain huit heures. »
Le narrateur finit par « prendre le coup de main » : il maîtrise la livraison de fuel, est enfin qualifié, et en toute logique, c’est alors que son patron le congédie !
Quand il me remet mon chèque, il me dit qu’il va me laisser partir.
« Il fait doux, dit-il. L’activité est quasiment au point mort. Un seul chauffeur me suffit pour tous les parcours. »
Je hoche la tête.
« Vous savez ce que c’est, le travail saisonnier. Vous avez fait du bon boulot. » Il me tape sur l’épaule.
Retour aux petites annonces.
Retour à la peinture, à la restauration, à la pêche aux crabes…
Ça lui file comme une rage, à notre héros. Et à mon avis, pas mal des « On vaut mieux que ça ! », pas mal des précaires, des stagiaires, des CDD à répétition, signeraient sa dernière page comme un manifeste :
Il y a de nombreuses façons de voir la chose. Ça ne va pas si mal. Je vis dans le pays le plus riche du monde ; même fauché ici vaut mieux que d’appartenir à la classe moyenne du Pérou ou de l’Angola. Je pourrais être un paysan sénégalais. C’est ça, c’est cette phrase qu’on devrait vous dire en vous remettant une licence de lettres le jour de la cérémonie, ou un petit chèque pour avoir toute votre énergie dans un boulot sans intérêt qui ne donne aucune satisfaction, dans une grande entreprise sans visage. « Voilà pour vous. Félicitations. Vous savez, vous pourriez être un paysan sénégalais. »
Ce n’est pas une question d’argent. Le véritable problème c’est que nous sommes tous considérés comme quantité négligeable. Un humain en vaut un autre. La loyauté et l’effort ne sont pas récompensés. Tout tourne autour des résultats financiers, un terme aussi détestable pour tout travailleur que « licenciement » ou « retraite forcée ». D’accord, nous avons fait des progrès depuis l’édification du barrage Hoover ou depuis que les ouvriers mourraient en construisant les voies ferrées, mais l’attitude des entreprises vis-à-vis de ceux qui accomplissent le travail est restée la même. Et le balancier revient dans l’autre sens. Ceux qui font les promesses sont si loin de tout qu’ils ne voient même plus que leurs promesses ne signifient rien. Des actions de votre entreprise au bout de cinq ans ? Super, merci. Mais nous savons tous les deux que, statistiquement, dans cinq ans je serai parti depuis longtemps.
Je regarde des matchs de foot et je vois se succéder des pubs pour des plans de retraite et des portefeuilles d’investissement, puis je regarde les autres clients du bar. A qui sont destinées ces pubs ? A personne d’ici. Pour ces types, un investissement à long terme c’est le foot du prochain lundi soir. Autrefois, on faisait des pubs pour des bières et des chips. Je fais partie d’une catégorie démographique qui n’est pas dans le champ du radar.
Je pourrais écrire un bouquin sur cette merde. Un million d’autres pourraient aussi.
Je me munis des petites annonces du dimanche, d’une tasse de café, et je m’assois à côté du téléphone.


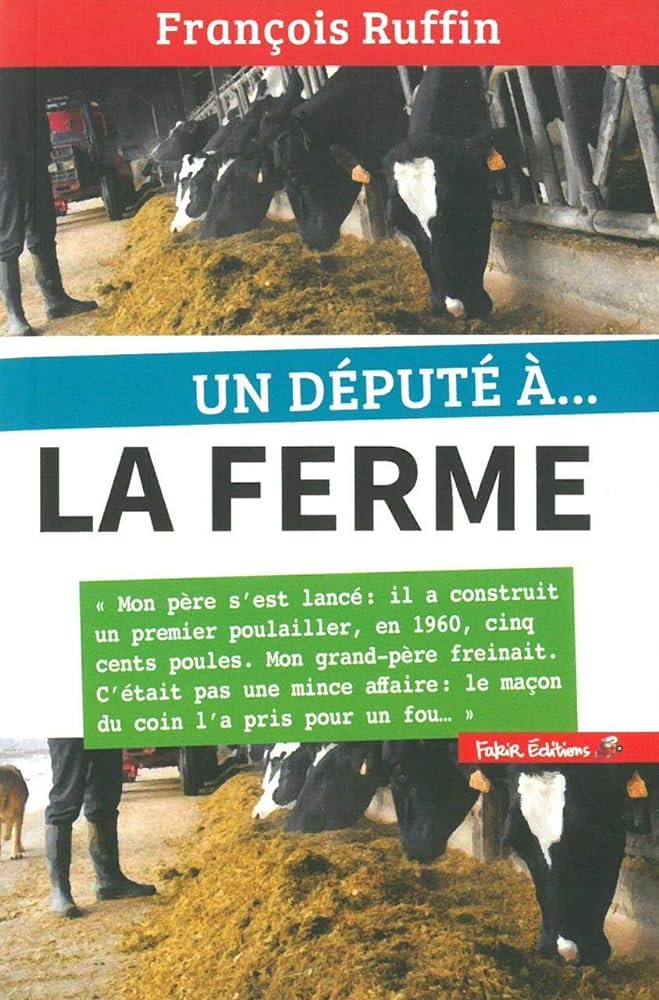





Messages
11 novembre 2016, 18:28, par Gueneton
Triste réalité
14 novembre 2016, 13:10, par Briandu64
petit mot pour la traduction : "il va me laisser partir."
qui provient très certainement de "he will let me go".
Cela ne se traduit pas exactement comme ça. Ainsi par exemple "I will let you know" ne se traduit pas par "je te laisserais savoir" mais par "je te le ferais savoir"
"Now I let you go" est une invitation à partir qui peut être très ferme. "Then I let him go" ça veut vraiment dire qu’on a demandé à quelqu’un de partir, ou qu’on l’a signifié très fortement. Ça ne signifie pas qu’on a "laissé partir" la personne à sa propre convenance.
14 novembre 2016, 13:19, par Olivier
Vous devriez lire Adam Smith, contemporain de Voltaire, considéré comme le père fondateur de l’économie. Dans "traité sur la richesse des nations", son ouvrage phare, il explique par exemple qu’il faut abandonner l’esclavage. Noble considération. Sauf que la raison l’est moins : il faut abandonner l’esclavage parce que ce n’est pas rentable. Ben oui, un esclave il faut le nourrir, l’habiller, le loger. Il faut aussi payer des gens armés pour le surveiller. Et puis, quant on parle de motivation au travail, la motivation d’un esclave doit être en dessous de zero. Pensez donc, quoi qu’il fasse il restera esclave toute sa vie, tout comme sa descendance, alors, s’il peut saboter le travail en cours il ne va pas se gêner.
Conflits, punitions, salauds d’esclaves, le travail n’avance pas.
C’est là le trait de génie d’Adam Smith : démontrer qu’il est bien plus rentable d’employer des ouvriers affamés qui vont se battre pour un salaire de misère, plutôt que des esclaves - au moins ceux là ils sont motivés.
Lisez le chapitre intitulé "salaires", c’est un monument.
Voilà, c’est ça les gênes de la Science Economique. Pas de raisons de s’étonner de ce qui en découle ...
18 novembre 2016, 20:24, par un plouk !
@Briandu64 : avec un air cynique, ça passe plutôt bien je trouve pourtant...