Une colère noire
par 15/03/2017 paru dans le Fakir n°(78 ) décembre 2016 - janvier 2017

On a besoin de vous
Le journal fakir est un journal papier, en vente dans tous les bons kiosques près de chez vous. Il ne peut réaliser des reportages que parce qu’il est acheté ou parce qu’on y est abonné !
Ce jeudi soir, au Havre, je rencontrai Assa Traoré, la soeur d’Adama.
A la demande Youcef, un membre de son collectif, je leur disais mon accord pour intervenir à l’Assemblée nationale, mais après avoir étudié le dossier, consciencieux comme reporter, soucieux de ma fonction de parlementaire, pour m’exprimer en mon âme et conscience et n’être le perroquet de personne. Je l’ai proposé avec tant de maladresses (j’en suis coutumier...) que certains ont entendu, d’autres on voulu entendre, l’inverse : un refus de soutenir.
Ce week-end, j’ai donc lu Lettre à Adama, par sa soeur Assa. Ce livre m’a rappelé Une Colère noire, de l’essayiste américain Ta-Nehisi Coates : une longue lettre que l’auteur adresse à son fils, attention bonhomme, noir et aux Etats-Unis, tu vas souffrir.
C’est déjà la référence qui m’était venue à l’esprit, il y a un an, après le drame à Beaumont-sur-Oise (en plus du superbe Home de Toni Morrisson).
Pour que nos banlieues ne ressemblent pas à Arlene ou Harlem, la peur qui règne sur les corps et les cœurs.
Beaumont-sur-Oise, vendredi 21 octobre.
« La famille d’Adama Traoré voudrait te joindre. Elle souhaiterait que tu organises, place de la République, une rencontre avec la famille de Rémi Fraisse. » C’est Pierre Baton, un copain du NPA, qui me fait cette offre.
« Tu serais d’accord pour que je leur donne ton numéro ?
— Mais bien sûr ! » Je suis carrément enthousiaste.
Taper sur la police, c’est pas trop mon truc.
J’ai le sentiment, parfois, que c’est comme un hochet qu’on met devant nous, pour faire joujou, et on s’énerve sur le hochet, et on y perd notre énergie, et on lâche la proie pour l’ombre.
N’empêche.
N’empêche : on se félicite, souvent, que grâce au préfet Maurice Grimault, mai 68 se soit déroulé sans un mort, malgré les cocktails Molotov qui pleuvaient. Et ce printemps, dans les manifs, combien d’estropiés ? Combien d’yeux perdus ? On ne les compte plus. Amal Bentounsi les compte, elle, les morts en banlieue, avec son collectif Urgence-notre-police-assassine. Une centaine de victimes, selon elle, entre 2005 et 2015.
N’empêche : il y a pire que les blessés, pire que les décès, peut-être. C’est l’impunité. Ce sont les mensonges d’Etat, les preuves déguisées, les vérités travesties, les fausses enquêtes internes, la Justice complice. Et pour les policiers, l’acquittement automatique.
N’empêche, je me méfie : il ne faudrait pas que ça devienne comme aux Etats-Unis, ces « bavures », une habitude, des meurtres semi-légaux, sans grande importance, parce que des Noirs, des jeunes, des quartiers.
Au moment où Adama Traoré mourait, je lisais des bouquins là-dessus justement. Le magnifique Home, de Toni Morrison (que vraiment je recommande) :
« Tu travailles dans quoi ? demanda Frank.
— L’acier, répondit Billy. Mais là, on est en grève donc je fais la queue à l’agence et je prends n’importe quel travail à la journée que je peux obtenir. » Auparavant, quand Billy avait présenté son fils à Frank, le garçon avait levé le bras gauche pour lui serrer la main. Frank avait remarqué que le droit pendait mollement sur le côté. À présent, tout en battant les cartes, il demanda à Billy ce qui était arrivé au bras de son fils. Billy plaça ses mains en position de tir.
« Un flic en voiture, dit-il. Le petit avait un pistolet à amorces. Huit ans, il courait d’un bout à l’autre du trottoir en pointant son jouet. Un péquenaud mal dégrossi trouvait que les autres flics sous-estimaient sa bite.
— Tu ne peux pas tirer sur un gamin comme ça, dit Frank.
— Les flics tirent sur tout ce qu’ils veulent. Ici, c’est une ville à émeutes. Arlene est devenue un peu dingue dans la salle des urgences. Deux fois ils l’ont jetée dehors. Mais en fin de compte ça s’est bien terminé. Le bras amoché l’a maintenu à l’écart des rues et en classe. C’est un génie des maths. Gagne concours sur concours. Les bourses pleuvent.
— Donc le jeune flic lui a rendu service.
— Non. Non, non, non. C’est Jésus qui est intervenu pour faire ça. Il a dit : ‘‘Attendez, monsieur l’agent. Ne faites pas de mal à ce petit. Celui qui blesse un de ces petits trouble ma tranquillité d’esprit.’’ »
Joli, se dit Frank. Un peu de Bible, ça marche à tous les coups et dans tous les endroits – sauf la zone de tir.
Le génie des maths n’eut aucune objection à dormir sur le canapé pour laisser son lit au nouvel ami de son père. Frank s’approcha du garçon dans sa chambre et lui dit : « Merci mon pote.
_ — Je m’appelle Thomas, répondit le garçon.
— Bon, d’accord, Thomas. J’entends dire que tu es bon en maths.
— Je suis bon en tout.
— Comme quoi ?
— Instruction civique, géographie, anglais. » Sa voix traînait comme s’il avait pu citer bien d’autres matières dans lesquelles il était bon.
« Tu iras loin, fiston.
— Et profond. »
Frank rit de l’imprudence de cet enfant de onze ans. « Tu fais quel sport ? » lui demanda-t-il, pensant que le garçon avait peut-être besoin d’un peu d’humilité. Mais Thomas lui lança un regard si froid que Frank se trouva embarrassé. « Je veux dire…
— Je sais ce que vous voulez dire », répondit-il et, comme contrepoint ou idée surgie après coup, il toisa Frank et lui lança : « Vous ne devriez pas boire.
— Bien vu. »
S’ensuivit un bref silence pendant que Thomas disposait sur le dessus d’un oreiller une couverture pliée et calait le tout sous son bras mort. À la porte de la chambre il se tourna vers Frank.
« Est-ce que vous étiez à la guerre ?
— J’y étais.
— Avez-vous tué quelqu’un ?
— Obligé.
— Comment vous êtes-vous senti ?
— Mal. Franchement mal.
— C’est bien. Que ça vous ait fait vous sentir mal. Je suis content.
— Comment ça ?
— Cela signifie que vous n’êtes pas un menteur.
— Tu es profond, Thomas, dit Frank en souriant.
Quel métier tu veux faire quand tu seras grand ? » De la main gauche, Thomas tourna la poignée et ouvrit la porte. « Homme » répondit-il, puis il sortit.
***
Dans la foulée, Nicole, mon ancienne prof de fac, devenue bénévole à Fakir, m’a offert Une colère noire, de Ta-Nehisi Coates. C’est une longue lettre que l’auteur, journaliste, adresse à son fils, un essai autobiographique :
Je t’écris dans ta quinzième année. Je t’écris car cette année tu as vu Éric Gardner se faire étrangler et tuer pour avoir vendu des cigarettes. Tu as vu des hommes en uniforme assassiner, de leur voiture, Tamir Rice, un enfant de douze ans qu’ils avaient juré par serment de protéger. Tu as vu des hommes dans ce même uniforme tabasser Marlene Pinnock, une grand-mère, sur le bas-côté d’une route. Et tu sais à présent – si jamais tu l’ignorais encore – que les services de police de ton pays ont été dotés du pouvoir de détruire ton corps. Peu importe que cette destruction soit le résultat d’une réaction malencontreuse et excessive. Peu importe qu’elle soit le fruit d’un malentendu. Les auteurs de cette destruction auront rarement des comptes à rendre. Pour la plupart, ils percevront leur retraite. Cette destruction n’est que la forme superlative d’une domination dont les prérogatives incluent la fouille, la détention, le passage à tabac et l’humiliation. Tout ceci est de l’histoire banale pour les Noirs. Tout ceci est de l’histoire ancienne.
Cette peur est si bien ancrée qu’elle marque toute l’éducation des parents. Qui délivrent eux-mêmes les coups, pour prévenir un plus tragique destin :
Quand j’avais six ans, Ma et Papa m’ont emmené dans un parc du quartier. J’ai échappé à leur surveillance, j’ai trouvé un terrain de jeu et ils m’ont perdu de vue. Tes grands-parents m’ont cherché partout avec angoisse pendant plusieurs minutes. Quand ils ont fini par me retrouver, Papa a fait ce que n’importe quel parent que je connaissais aurait fait – il a pris sa ceinture. Je me rappelle que je le regardais avec une sorte de stupéfaction, admiratif et craintif à la fois face à la disproportion entre la punition et l’offense. Plus tard, il le dirait clairement : « Soit c’est moi qui le bats, soit ce sera la police. » Peut-être que ça m’a sauvé. Peut-être que non. Tout ce que je sais, c’est qu’à l’époque, la violence naissait de la peur comme la fumée naît du feu, et je suis incapable de dire si cette violence, même administrée dans la peur et dans l’amour, nous réveillait ou nous étranglait. Ce que je sais, en revanche, c’est que les pères qui frappaient leurs fils adolescents pour punir un soupçon d’effronterie les laissaient ensuite redescendre dans la rue, où eux-mêmes appliquaient – et subissaient – la même forme de justice. Je connaissais aussi des mères qui punissaient leurs filles avec le ceinturon, mais le ceinturon ne les sauverait pas de l’emprise des dealers deux fois plus âgés qu’elles. Nous, les enfants, nous pratiquions un humour des plus cyniques pour supporter tout ça. On rigolait, mais je sais qu’au fond on craignait ceux qui nous aimaient le plus. Nos parents s’en remettaient au fouet comme les pénitents à l’époque de la peste.
Pour l’auteur, l’école participe de ce système, de cette violence :
J’en suis venu à considérer la rue et l’école comme les deux bras d’un même monstre. L’une profitait du pouvoir officiel de l’État tandis que l’autre s’appuyait sur son approbation implicite. Mais c’est la peur et la violence qui constituaient leur arsenal. Si tu échouais dans la rue, les bandes profitaient de ta chute et s’emparaient de ton corps. Si tu échouais à l’école, tu en étais renvoyé et tu finissais par atterrir dans cette même rue, où les bandes s’emparaient, à peine un peu plus tard, de ton corps. J’ai donc commencé à comprendre la relation qui unissait ces deux bras. Ceux qui se retrouvaient en situation d’échec à l’école offraient à la société toutes les armes pour justifier leur destruction dans la rue. La société pouvait dire : « Il aurait dû rester à l’école », et s’en laver les mains. Que les « intentions » de chaque éducateur individuel aient été nobles n’a aucune importance. Oublie les intentions. Ce que n’importe quelle institution – ou n’importe lequel de ses agents – a comme « intention » à ton égard demeure secondaire.
Notre monde est un monde physique. Il faut que tu apprennes à jouer défensif : ignorer ce que dit la tête et ne pas quitter le corps de tes yeux.
C’est, pour Ta-Nehisi Coates, le fruit d’une histoire, et d’une histoire américaine, avec l’esclavage et ses séquelles :
À l’époque des lynchages de masse, il était si difficile de savoir qui, précisément, était le bourreau que de telles morts étaient souvent rapportées par la presse comme ayant eu lieu « des mains de personnes inconnues ». En 1957, les habitants blancs de la ville de Levittown, en Pennsylvanie, ont pris position pour conserver leur droit à la ségrégation. « En tant que citoyens moraux, religieux et respectueux de la loi, écrivaient-ils, nous pensons que notre volonté de maintenir fermée notre communauté est impartiale et non discriminatoire. » Ils tentaient de commettre un acte honteux en échappant à toute sanction, et si je t’en parle, c’est pour te montrer qu’il n’y a jamais eu d’âge d’or pendant lequel les scélérats auraient fait leur besogne tout en la revendiquant haut et fort. « Nous aimerions pouvoir dire que de telles personnes ne peuvent pas exister, qu’il n’en existe pas, écrit Soljenitsyne. Pour faire le mal, un être humain doit croire tout d’abord que ce qu’il fait est bon, ou bien que c’est un acte mûrement réfléchi et conforme aux lois naturelles. »
Le seul répit, dans sa vie, dans ce livre, c’est Paris, où l’entraîne sa femme :
Je suis arrivé à Paris. J’ai pris une chambre dans un hôtel du VIe arrondissement. Je ne connaissais absolument rien de l’histoire locale. On était vendredi, et les rues bondées étaient le théâtre de rituels incroyables. Des ados ensemble dans des cafés. Des écoliers tapant dans un ballon de foot en pleine rue, leurs sacs à dos jetés par terre. Des couples âgés dans de longs manteaux, ou en blazers, avec des écharpes entortillées. Des gens de vingt ans penchés à des fenêtres, beaux et cool. Ça me rappelait New-York, sans cette saleté de peur permanente. Le lendemain, je me suis levé tôt et j’ai marché dans la ville. J’ai visité le musée Rodin. Je me suis arrêté dans un bistrot et, avec toute l’appréhension d’un garçon approchant une jolie fille dans une fête, j’ai commandé deux bières, puis un hamburger. J’ai marché vers le jardin du Luxembourg. Il était à peu près seize heures. Je me suis assis. Le jardin était plein de gens, toujours occupés de leur manière étrange. À cet instant, j’ai eu un sentiment bizarre de solitude. En Amérique, je faisais partie de l’équation – même si ce n’était pas la partie de l’équation que je préférais. J’étais celui que la police arrêtait sur la 23e rue en pleine journée de travail. J’étais celui qui avait eu cette attirance pour La Mecque. Je n’étais pas seulement un père, mais le père d’un garçon noir. Je n’étais pas seulement un mari, mais le mari d’une femme noire, un symbole chargé de l’amour noir. Dans ce jardin public en revanche, pour la première fois, j’étais un étranger, j’étais un marin – sans terre et sans attaches. J’étais triste de ne jamais avoir senti cette solitude singulière auparavant.
L’été suivant, lui revient à Paris, avec son fils cette fois :
Nous entrons dans nos dernières années de vie commune, et j’aurais aimé avoir été plus doux avec toi. Ta mère a dû m’apprendre comment t’exprimer mon affection – comment t’embrasser et te dire je t’aime tous les soirs. Aujourd’hui encore, ce n’est pas tant un acte naturel qu’un rituel. Parce que je suis meurtri. Parce que je suis attaché à des manières anciennes apprises dans un foyer brutal. C’était un foyer aimant, malgré les agressions de son pays, mais il était, de fait, brutal. Je voulais mettre le plus de distance possible entre toi et cette peur aveuglante. C’est vrai, notre couleur de peau n’est pas un signe distinctif à Paris, pas autant que le fait d’être américain, dont témoignait notre piètre maîtrise du français. Il faut dire qu’il y a quelque chose de très spécial dans la manière dont les Américains qui se croient blancs nous considèrent – quelque chose de sexuel et d’obscène. Nous n’avons pas été réduits à l’esclavage en France. Nous ne sommes pas le « problème » particulier des Français, ni leur fierté nationale. Nous ne sommes pas leurs nègres.
Je me demande où nous en sommes, dans cette histoire. À quelle vitesse nous glissons.
À quel rythme nos esprits s’amollissent, tenant pour normal, bientôt, que la paix publique soit préservée à tout prix par les coups et la peur du gendarme.
À quelle allure, justement, se répand cette peur, des peurs symétriques, de la police et des « jeunes », dans les quartiers et dans les campagnes. Comme des angoisses en miroir. Pour que nos banlieues ne deviennent ni la Lotus de Home, ni le Harlem de Ta-Nehisi Coates.

Article mis à jour le 26 septembre à 10h07.


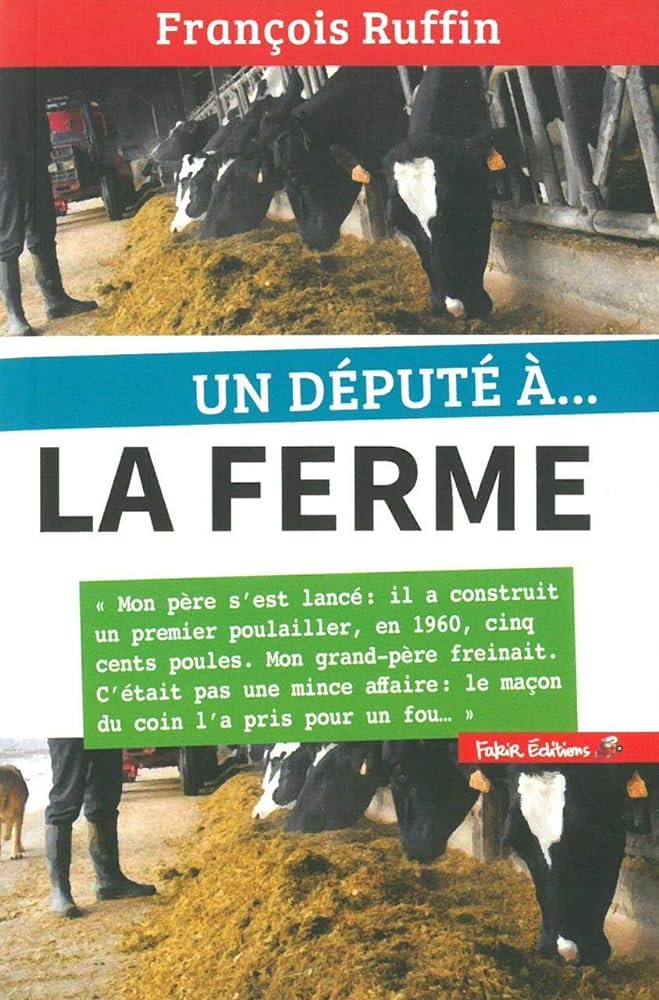





Messages
17 mars 2017, 17:17, par abecassis
Wouah . Très , très . J’écris après avoir lu les extraits de ce livre . C’est réaliste et dans la poésie du " il faut faire sans... ou avec " J’ai fais une capture d’écran pour avoir les références de ces livres . A bientôt .