Livres à la chaîne
par 24/06/2014 paru dans le Fakir n°(64 ) février - avril 2014
On a besoin de vous
Le journal fakir est un journal papier, en vente dans tous les bons kiosques près de chez vous. Il ne peut réaliser des reportages que parce qu’il est acheté ou parce qu’on y est abonné !
Ouvrier chez Goodyear, Patrick Habare était passé à Fakir pour déposer ses textes, y a une paire d’années. On les a ressortis du placard.
Patrick Habare était passé au local, il y a une paire d’années, pour déposer ses textes. On les avait lus, fallait les déchiffrer, c’était écrit à la main, d’une écriture en patte de mouches, et on a eu la flemme de transcrire ces pages. On les a déposées dans un tiroir, pour plus tard, et avec les derniers soubresauts de Goodyear, là, Éric a eu l’idée de les ressortir.
Avant de les publier, je suis allé rencontrer l’auteur, qu’on choisisse les extraits ensemble, qu’on trie dans ses papiers. Son appartement, c’est pire qu’une discothèque, des étagères sur tous les murs, des milliers de CD. Là, il écoutait « Rabih Abou-Khalil, un Pakistanais qui réside en Allemagne », il m’a expliqué.
« Et vous, vous jouez de la musique ? j’ai demandé.
— Oui, avant.
— Avant quoi ? »
Il m’a montré sa main gauche, où manquent deux doigts, et l’auriculaire bloqué.
« C’est à cause de l’usine ?
— Oui. Je remplaçais un collègue pendant les congés. J’avais quatre presses en charge. Et la sécurité sur ces machines, tu sais comment ça marche, c’est un rayon et dès qu’il voit quelque chose en dessous, la machine s’arrête. Et nous, pour faire le quota de production, il fallait qu’on nettoie le moule pendant la fermeture de la presse.
« Donc la presse n°4, y avait eu un accident, dessus, déjà. Ils avaient remis la sécurité. Mais ils l’ont remise que sur cette presse.
« La presse n°2, c’était moi. C’était ma deuxième journée à ce poste, le mardi 13 juillet 1993. Après moi, ils ont remis la sécurité… mais que sur cette presse.
« La presse n°1, c’est un délégué CFDT, il s’est battu, pendant des années, pour que la sécurité soit remise, et à la fin ils ont accepté… mais que sur cette presse.
« La quatrième presse, le gars y a perdu tous les doigts de sa main droite.
« Peu de temps après ça, ils ont pris toutes les presses, ils les ont emmenées en Pologne. Je doute que là-bas ils aient remonté les sécurités.
« Je voulais en faire un texte, mais je voyais pas comment en tirer quelque chose de drôle…
— C’est drôle, pourtant, en un sens ! Ils avaient un sacré humour noir ! »
Dans cette usine j’ai lu ...
L’an dernier, Patrick Habare a envoyé une lettre de candidature à France Inter, pour devenir juré du livre Inter. Voici comment il se présentait :
Je suis ouvrier chez Goodyear, dans une usine qui a employé mon père pendant plus de vingt ans, mon frère aîné pendant une quarantaine d’années et moi-même depuis plus de vingt cinq ans.
Je travaille dans une usine qui m’a mangé trois doigts et de laquelle je vais bientôt être mis à la porte, mais aussi une usine au sein de laquelle j’ai lu tant de livres. Là, j’interromps la lecture d’Ulysse de James Joyce pour vous écrire.

J’optimise au maximum mes méthodes de travail, tout en faisant correctement mon boulot, afin de gagner le maximum de temps de pause, c’est-à-dire mon temps de lecture. C’est dans cette usine que j’ai lu, entre autres, Les Rougon Macquart de Zola [on parle très peu de l’humour de Zola et pourtant... celui qui ma le plus fait rire : La Conquête de Plassans (vous connaissez le sketch de Coluche intitulé « L’auto-stoppeur » ? Eh bien c’est un peu la même histoire, le même humour)] C’est dans l’escalier de secours du vestiaire n°3 et sa tranquillité que j’ai lu Les Croisades vues par les arabes d’Amin Maalouf. C’est sur le temps grignoté miette à miette que j’ai lu aussi des livres de science-fiction (Philip K. Dick, Pierre Bordage, Barjavel etc.) des romans historiques (Les Rois Maudits de Maurice Druon, Fortune de France de Robert Merle, Alexandre Dumas etc.) des polars par centaines.
C’est à l’intérieur de l’enceinte de l’usine mais loin du fracas des machines, que, l’été, au milieu des lapins batifolants, dans la pelouse séparant l’atelier de l’entrepôt, j’ai ri en lisant Sublimes Paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja, Pourquoi j’ai mangé mon père de Roy Lewis, La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole etc. Bien sûr, je lis également en dehors de l’usine. Chez moi je n’ai ni télévision, ni Internet ni même téléphone portable : pour avoir du temps de lecture cela aide beaucoup. J’ai appris à lire avec les premières expérimentations de la méthode globale. À la sortie du CP je lisais couramment et depuis je n’ai cessé de lire (à l’école primaire Jules Verne, Le Capitaine Fracasse de T. Gautier, etc.) Après avoir raté le bac [je n’ai pas lu les livres qu’il fallait (je les ai lus plus tard). À l’époque je lisais surtout la presse rock spécialisée (Best, Rock & Folk...) ainsi que des œuvres non inscrites au programme de terminale Do it de Jerry Rubin mais aussi Les Écritures de Cavanna ou L’automne à Pékin de Boris Vian (certainement moins émouvant que L’écume des jours mais beaucoup plus délirant)) etc.] j’ai obtenu mon premier emploi à la « Coop », une plate-forme de distribution alimentaire.
Mon emploi consistait à préparer les commandes que nous faisaient parvenir les différentes succursales des magasins de quartier « Coop » de Picardie. Pour gagner du temps consacré à la lecture, je mémorisais les commandes dix lignes par dix lignes. Ce qui m’a permis de lire, entre autres, Le Château de Kafka, L’Histoire du Jazz de H. Panassié, Mémoires d’un vieux con de R. Topor et aussi, bien sûr, Cavanna et Boris Vian etc. Après six ans passés essentiellement à lire (je faisais en deux à trois heures le travail ce que mes collègues effectuaient en huit heures) l’entreprise a périclité avec le développement des grandes surfaces et j’ai dû rechercher un nouvel emploi. Après quinze jours de chômage, je fus embauché chez Goodyear en janvier 1988. […] Sur ce, je retourne à la lecture de James Joyce. Bien que je lise très très lentement, je suis sûr que plein de choses ont échappé à ma compréhension...
Johnny et Ch’dindon
Lundi 21 novembre 2011 – 17h15 – Pause
Quand j’entre dans le fumoir, Gainsbourg évoque « le bon vieux temps » devant un auditoire composé de deux ouvriers, plus jeunes, plongés dans leurs téléphones portables. Dans tous les fumoirs, de toutes les entreprises : « C’était toujours mieux avant... à l’époque où le paquet de “Gauloises” coûtait à 1 F50. » Dès mon entrée dans le monde du travail, en 1980, c’était déjà mieux avant. Outre « Gainsbourg », qui est souvent au fumoir, d’autres de mes collègues sont affublés d’un surnom. Ainsi nous avons « La cigogne », qui est grande et maigre. Nous aurions pu avoir, dans le même genre, « L’hippopotame », mais personne n’a osé, il est trop costaud. Notre équipe comporte aussi « Pouêt-pouêt » qui conduit un engin motorisé qui fait pouêt-pouêt, et « Johnny » dont la voiture est ornée d’un pare-soleil « Johnny ». (Il paraît que chez lui, tout est « Johnny », du papier peint à la parure de lit... « Johnny »... il est parti en retraite cette année avec un cancer.) Parmi les surnoms mythiques nous avions « Ch’dindon » parti en retraite depuis quelques années. Un Noël, il avait mangé une énooorme dinde, tellement grooosse qu’avec la carcasse il avait fait une niche pour ch’chien. Nous avons aussi « Pépito », un black d’origine togolaise.
Mais bon ! On ne sait pas toujours de quel surnom nous affublent les collègues quand nous avons le dos tourné.

Tout le monde l’a signée
C’était en 1995.
La mère de mes enfants désirait se remarier avec un Tunisien en situation illégale. Face aux problèmes rencontrés, elle avait lancé une pétition afin d’éviter son extradition. J’ai longuement hésité avant de proposer cette pétition à mes collègues de travail. On entend tellement de propos racistes dans l’usine... je me suis dit « ce n’est pas la peine, je vais me faire jeter tout de suite ». Et ce n’est qu’après avoir recueilli plus d’une centaine de signatures hors de l’usine que j’ai quand même osé présenter la pétition à mes collègues, pensant ne récupérer que quelques signatures. Mais, à ma très grande surprise, toutes les personnes du secteur « finition » de mon équipe l’ont signée. Toutes ! Pas une seule personne n’a refusé de signer. De nombreux ouvriers du secteur « construction », que je ne connaissais pas, ayant eu vent de cette pétition, sont venus me trouver spontanément... Presque une centaine de signatures, rien qu’à l’usine. Les ouvriers Goodyear, je leur tire mon chapeau.
Une petite anecdote qui m’a fait sourire : la pétition comportait plusieurs colonnes. La première (nom-prénom) était suivie de celle indiquant la ville de résidence. Sur l’une des feuilles, le premier signataire habitait la ville d’Albert. Tous les ouvriers suivants ont écrit leur prénom dans cette colonne.
Elle tire sa robe...
L’usine est un monde d’homme. La présence féminine y est infime. Aussi, lorsqu’une meuf traverse l’usine, aussitôt tous les regards se braquent sur elle. C’était au début des années 2000, je me trouve dans un recoin, devant un appareil à boisson quand je vois arriver Laurence, qui travaille dans les services administratifs. Elle regarde droit devant elle et ne m’a pas vu. Elle porte une robe, pas tout à fait ras-la-moule, mais presque. Je souris en songeant au parcours qu’elle a effectué avant de parvenir jusque là. Elle a dû descendre un escalier et longer le poste de travail des six inspecteurs tourisme. Soudain, alors qu’elle se trouve derrière la seule palette qui pouvait l’abritait de tous les regards (sauf du mien), elle stoppe ! Et là, pendant quelques secondes, elle tire... tire sa robe vers le bas.... en vain évidement. J’éclate de rire à la vue de ce furtif intermède tandis qu’elle bifurque derrière la palette et continue ainsi sa traversée de l’usine, comme si de rien n’était. Laurence, nous étions dans la même classe au lycée, mais elle, elle faisait partie des bons élèves. Elle travaille maintenant chez Dunlop, à côté. Laurence, tu nous manques, tes apparitions dans l’usine nous remontaient le moral... pas seulement le moral...
Cette odeur me revient
J’aurais préféré exercer la profession de « maître du monde », j’aurais oeuvré pour la paix mondiale en aplanissant toutes les inégalités sociales. Mais, malheureusement pour l’humanité, j’ai dû me contenter d’un emploi chez Goodyear. Mon boulot à moi consiste à contrôler visuellement des pneus agraires afin de détecter le moindre défaut éventuel, puis de le rendre présentable avant de le stocker en palette. C’est un travail très physique. J’étais âgé d’une dizaine d’année lorsque je suis entré pour la première fois dans l’usine. C’était avec mon père en Mai 68 lors de l’occupation de l’usine. Le souvenir que j’ai gardé de cette première visite fut avant tout l’odeur nauséabonde qui empuantissait l’usine. Cette odeur, je l’ai retrouvé le 11 janvier 1988 lors de mon embauche. Embauche que je dois à mon frère. Lui-même employé dans l’entreprise en même temps que directeur bénévole du refuge SPA proche de l’usine. Cela fait donc presque 24 ans que je baigne dans cette odeur. Je m’y suis habitué. Il n’y a plus guère qu’une fois par an, lors de la reprise du travail après 4 semaines de congés payés, qu’elle me revient aux narines. J’ai la chance d’occuper un poste de travail en bout de chaîne. Cela me permet de gérer au mieux mon temps de travail et, par conséquent, mon temps de pause. Avant d’occuper ce poste, j’ai travaillé, assez peu de temps, sur la chaîne de contrôle des pneus tourisme. Il était impossible de s’absenter de la chaîne en dehors des pauses légales : c’est-à-dire 2 x 10 mn pour les pauses cigarettes et 1 x 30 mn pour la pause cantine. Ces 50 mn ne sont pas extensibles.
Fringues et parfum
Le principal sujet de conversation, avant même les commentaires sur le travail, reste : le football. Ce sujet intéresse toutes les générations tel un véritable « opium du peuple ». Viennent ensuite, les commentaires sur les infos du journal télévisé, les seules auxquelles je puis prendre part.

J’ai noté que, depuis quelques années déjà, un nouveau sujet de débat est apparu parmi les plus jeunes générations : les marques de fringues et même de parfum. Ce qui était impensable auparavant. Parallèlement à cette intrusion dans les conversations, un sujet qui tend à disparaître et qui était omniprésent : les souvenirs du service militaire. Récemment encore j’ai assisté à l’un de ces récits, « moi où j’étais fallait faire attention parce que les gens là-bas, y sont beaucoup antimilitarisme ». La plupart des anciens n’y ont passé qu’une année de leur vie mais cette année Je les comprends un peu, même s’il n’a duré pour qu’une journée et demie, j’en garde toujours un souvenir marquant.
Je vis après l’usine
Nous travaillons du lundi au vendredi en 3x8. Une semaine de nuit, une semaine d’A-M puis du matin et ainsi de suite. Quelle que soit la semaine, ma journée est divisée ainsi : je me lève pour aller bosser, c’est en sortant de l’usine que je vis, avant de dormir. La semaine de nuit, contrairement à la plupart de mes collègues, c’est l’après-midi que je dors. Pour moi la semaine la plus difficile, c’est la semaine du matin ; c’est celle où je manque le plus de sommeil. Avec l’âge, j’ai de plus en plus besoin de récupérer et il n’est pas rare que je passe des week-ends entiers à dormir, nuits et jours. Jusqu’à ce qu’ils créent des équipes de weekend, nous travaillions en 4x8. Maintenant, à de plus de cinquante ans, je ne serais plus capable de tenir un tel rythme. En 24 ans de carrière dans l’entreprise, je n’ai jamais été absent une seule journée pour maladie. Cela n’aurait pas été le cas s’ils avaient réussi à nous imposer un système de rotation comme ils l’ont fait dans l’usine Goodyear-Dunlop voisine. Malgré toute ma bonne volonté, avec ce système, je serais contraint de m’arrêter régulièrement en présentant un certificat médical justifié.
Devenu triste et méfiant
Avant de partir, et que Patrick se couche (il revenait d’une nuit d’occupation), il me montre une annonce, qu’il a placardée dans l’usine. Y a un chat en photo :
Je m’appelle Goody, j’ai trois ans. J’ai débuté mon existence dans un hangar dans lequel une cinquantaine de personnes de toutes les équipes se sont relayées pour me nourrir, me choyer. Lors de mes premières sorties, j’ai rencontré encore beaucoup d’autres personnes charitables, notamment parmi le personnel de la cantine ou du poste de garde où quelques gardiens ont relayé les ouvriers pour me nourrir et me câliner lors des fermetures annuelles de l’usine. Malheureusement, j’ai aussi été victime de sévices de la part de quelques gros cons. J’ai été traqué, molesté, attrapé par la queue et jeté en l’air ; on a tenté de m’étrangler, mes cordes vocales ont été atteintes et j’ai maintenant un miaulement plus rauque. Je suis maintenant devenu triste et méfiant. De plus, depuis l’incident du transformateur qui a coûté la vie à la mère de mes enfants, je suis traqué par la fourrière.
Patrick et son frère Alain - président de la SPA en face de l’usine - songent aussi à ces victimes inattendues de la fermeture : le reclassement, c’est pour tout le monde...


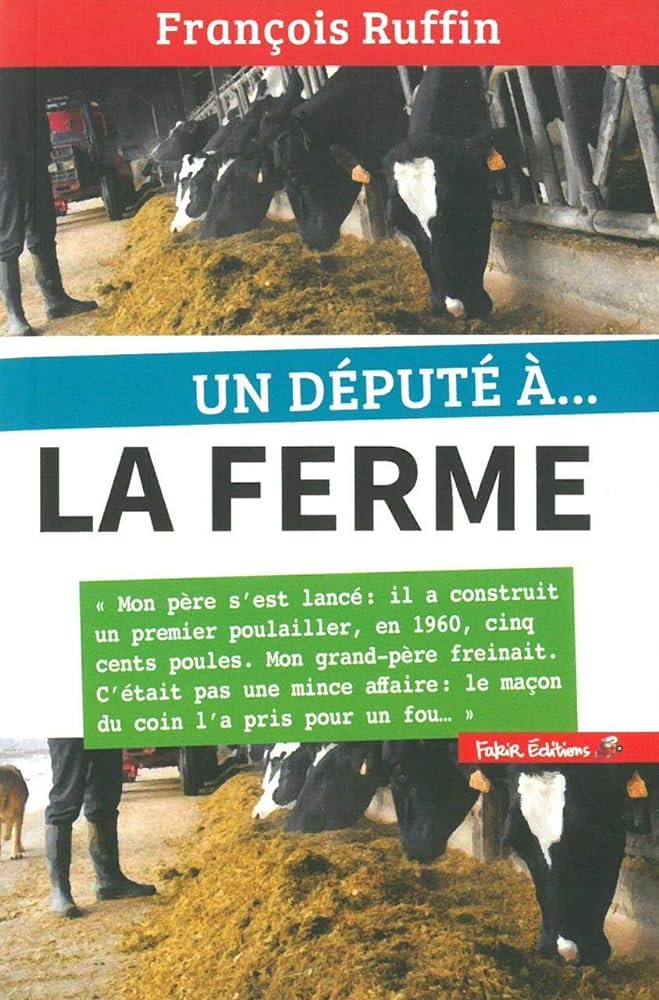





Messages
22 juillet 2014, 08:01, par Marc
la suite sera-t-elle publiée ?
J’ai hate !
22 juillet 2014, 19:06, par Sylvain
Salut Marc,
Si mes souvenirs sont bons, l’article est entier ici-présent !
Fakirement,
Sylvain
1er février 2016, 13:57, par Azza
Rabih Abu Khalil est libanais !
1er février 2016, 14:37, par Azza
Ca prend aux tripes