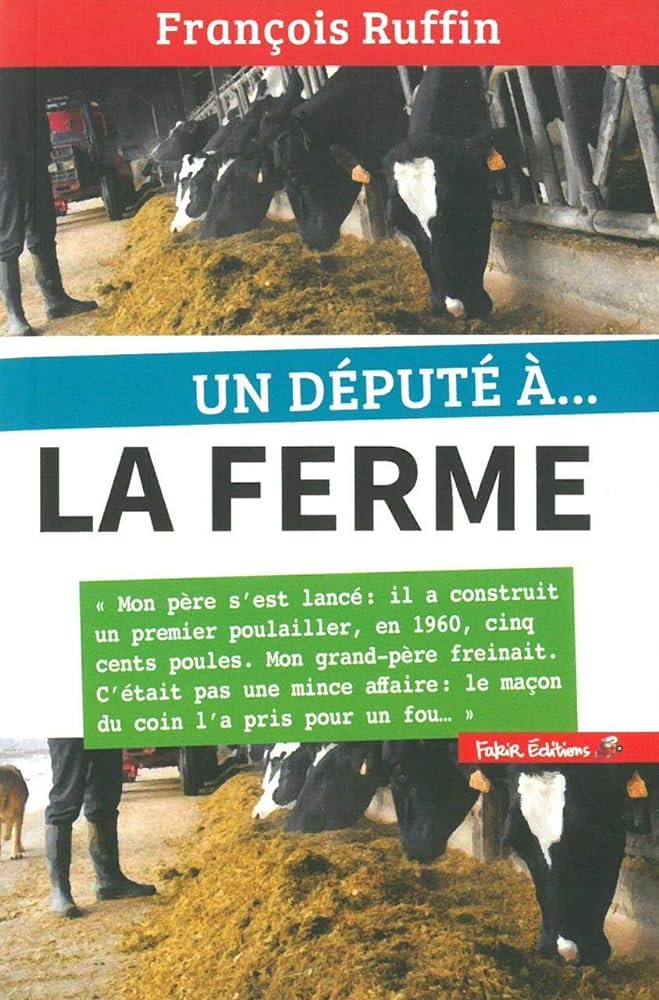Le bricolage de l’État social
par , 06/12/2013 paru dans le Fakir n°(60) avril - juin 2013
On a besoin de vous
Le journal fakir est un journal papier, en vente dans tous les bons kiosques près de chez vous. Il ne peut réaliser des reportages que parce qu’il est acheté ou parce qu’on y est abonné !
Numéro après numéro, on s’applique à écrire le « Dictionnaire des conquêtes sociales ». Et le chemin de ces acquis nous apparaît souvent plein de méandres, sans plan d’action, sans cohérence, du bricolage. Aussi, quand on a lu « L’État social » de l’économiste Christophe Ramaux, on a trouvé une proximité avec nos réflexions. Lui regrettant, également, que cet état social se construise sans théorie, et tentant d’en poser les fondements.
Fakir : Après la grève sur les retraites, en 2010, on a lancé une rubrique consacrée aux conquêtes sociales, Wikiluttes. Le but, dès le départ, c’était de combattre un certain défaitisme, « on a manifesté, on a bloqué la zone industrielle, mais tout cela n’a servi à rien », en montrant que le mouvement ouvrier allait de défaites en défaites, mais que ces échecs portaient souvent leurs fruits bien plus tard. Ainsi, le 1er mai 1906, il y a une grève générale pour les huit heures, qui ne sont pas accordées, mais à la place est obtenu le repos dominical. Et plus on avance dans nos recherches, moins ce chemin vers le progrès social nous paraît rectiligne : la CGT s’oppose en 1910 aux retraites ouvrières. Plus que les syndicats, encore faibles, ce sont les chrétiens philanthropes qui se sont chargés de dénoncer le travail des enfants, etc. Et c’est la Première Guerre mondiale qui accouche du congé maternité, de l’impôt sur le revenu, des huit heures… Dans ton livre, on retrouve ce propos : l’État social apparaît comme une sorte de bricolage, qui s’étale sur des décennies, sans un plan d’action défini.
Christophe Ramaux : En effet, l’État social est une construction pragmatique, laborieuse. On associe souvent, à tort, sa création aux trente glorieuses, alors que l’essentiel s’est joué à la fin du XIXe siècle. À cette époque s’impose l’idée que, si l’initiative privée a du bon, il y a des choses que le capitalisme ne sait pas faire : le plein-emploi, la stabilité financière, les retraites, la santé... Mais tout cela s’est construit sans véritable théorie, chaque pays a développé son propre État social à travers des compromis sociaux propres à son histoire, et avec des empilements de lois, sans que l’on perçoive vraiment la cohérence générale. Mais faites attention à ne pas réduire l’État social à la protection sociale : on oublierait alors son véritable potentiel révolutionnaire. Il faut, selon moi, distinguer quatre grands piliers :
1– vous l’avez mentionnée : la protection sociale ;
2– les instruments de régulation des rapports de travail et de production (le droit du travail notamment) ;
3– les services publics ;
4– et enfin celui que l’on oublie, laisse systématiquement de côté, alors qu’il est essentiel : les politiques économiques (les politiques des revenus, budgétaire, monétaire, industrielle, commerciale...).
Une fois saisi dans sa totalité, on découvre que l’état social est colossal.

**[*« Le potentiel révolutionnaire, déjà là »*]
Fakir : Là où l’extrême gauche souhaitait, ou souhaite encore, en finir avec le capital, le capitalisme, le marché, vous, ce que vous cherchez, au fond, c’est à faire coexister l’État avec le marché, avec le capital, avec le capitalisme ?
C. R. : C’est vrai, je ne suis pas pour supprimer totalement le capital et les initiatives privées – qui peuvent d’ailleurs être non capitalistes (avec les associations, les mutuelles, etc.). La question pertinente à poser me semble plutôt : qu’est-ce qui doit dominer ? Le capital, et en particulier le grand capital de la finance et des firmes, comme aujourd’hui ? Ou alors la démocratie, le suffrage universel, avec des instruments de défense de la société tel que l’État social ? Je suis donc partisan d’une économie mixte, mais avec la domination du suffrage universel et de la démocratie. Ce n’est peut-être pas un message radical pour petite salle surchauffée, mais c’est un message qui peut faire aisément majorité. Et sans cette majorité, la société ne sera pas transformée. Le néolibéralisme peut très bien s’accommoder d’une opposition radicale, inconséquente, qui fait 5 % ou 10 % aux élections et qui se tient chaud dans ses cercles militants.
Fakir : Quand nous avons lancé cette rubrique, il s’agissait également de nous inscrire contre, on dirait, un certain « millénarisme révolutionnaire » : « du passé faisons table rase », soit la Révolution éclate et balaie tout, et le paradis sur terre advient, soit on n’a rien… Vous, vous vous situez dans un courant gradualiste, « réformiste ».
C. R. : Si vous voulez, réformiste. Mais, pour moi, l’État social est révolutionnaire.
Fakir : Tout comme Jean Jaurès se revendiquait « réformiste révolutionnaire »…
C. R. : On a cette chose immense, formidable, sous les yeux : l’état social. Et il faudrait qu’on invente quelque chose de complètement nouveau ? Faire table rase de ça également ? Eh bien non : partons de ce qui existe, faisons-le grandir, portons-le dans de nouvelles directions – écologiques, notamment. Bref, appuyons-nous, pour bâtir l’avenir, sur ce qui est déjà là massivement et dont nous n’avons pas saisi toute la portée. Pour cela, il faut surmonter un obstacle mental : dans toute une tradition intellectuelle à gauche, dans la pensée marxiste en particulier, l’état est « bourgeois ». Des compromis provisoires existent certes, mais l’État serait fondamentalement au service des seuls dominants. Il conviendrait donc de le renverser. D’où le projet d’émancipation centré sur l’idée de dépérissement de l’État. Pour saisir le potentiel révolutionnaire de l’État social, il faut sortir de Marx.
**[*« Le néolibéralisme, lui, avance avec un projet »*]
Fakir : Donc l’état social, d’après vous, n’est pas solidement, intellectuellement, défendu ? Voire, il est attaqué sur un double front : à droite, les libéraux veulent réduire, voire supprimer, son intervention, et à gauche, une tradition marxiste fustige l’état.
C. R. : Le premier économiste à vraiment proposer une vision positive de l’État, à le formaliser un peu, c’est Keynes. Keynes, on l’oublie souvent, a salué la révolution russe. Au début de celle-ci, il écrit une lettre à sa mère où il se déclare « joyeusement bolchévique » Lors de son voyage de noces, avec une Russe, en Union soviétique, il fait un discours enthousiaste devant l’Académie des sciences. Rapidement, et non sans raison, il va condamner le régime communiste. Ensuite Keynes et ses successeurs vont en quelque sorte être prisonniers de la guerre froide : puisqu’ils sont contre le communisme tel qu’il se construit, ils sont nécessairement pour le capitalisme. De fait, la plupart des travaux keynésiens vont porter sur les politiques économiques (monétaire et budgétaire) nécessaires pour soutenir l’accumulation privée du capital. Pourtant, il y a avec les keynésiens les linéaments d’une théorie de l’état social : l’idée que le marché ne peut tout faire, etc. Mais pas à proprement parler de théorie.
Fakir : Et en quoi c’est un problème, finalement, qu’on n’ait pas de théorie de l’État social ? L’essentiel c’est qu’il existe, après tout, même sans théorie ?
C. R. : Le souci, c’est que ça le rend très fragile. Il y a des théories économiques pour légitimer le marché, mais pas l’équivalent pour légitimer l’état social. Cette absence de fondements intellectuels solides en fait une cible facile. L’essentiel, surtout dans les grandes périodes de crise, ce sont les idées, les projets. Aujourd’hui, le néolibéralisme ne tient plus par ses promesses, ni par ses réalisations, mais par l’absence d’alternative cohérente.
**[*« L’état social est toujours là, immense »*]
Fakir : Mais qu’en reste-t-il, justement, de cet état social, après trente ans de déferlante libérale ?
C. R. : D’abord, il faut voir la cohérence de cette offensive. Les libéraux ont bien perçu, eux, l’importance de l’état social dans sa totalité : ils s’en sont pris simultanément aux quatre piliers. Maintenant, puisque vous parliez de « défaitisme » tout à l’heure, il est important de ne pas sombrer dans ce travers, tomber dans le catastrophisme. Je taquine parfois certains de mes collègues en les surnommant les « t’as vu, ça y est ». Ils arrivent le matin en disant : « tu as vu ce qu’ils ont fait », « ça y est, ils l’ont fait », en laissant entendre que cette fois, c’est fini, il ne reste plus rien. Je réponds : « attention, ne laissons pas entendre que les carottes sont cuites ! » Au risque de scier notre branche d’appui pour la riposte. Malgré les attaques, l’état social est toujours là, et bien là. Il n’a pas disparu. Il a été déstabilisé, remis en cause, plus ou moins fortement selon les piliers et les pays, mais il n’a pas été mis à bas. Prenons le premier pilier. En moyenne, dans les pays de l’OCDE [Organisation de la coopération et du développement économiques], les dépenses de protections sociales publiques sont plus importantes (de plus d’un quart) aujourd’hui que dans les années 1980 ! En France, le budget global de la protection sociale, c’est plus de 600 milliards d’euros. La retraite, la santé, les allocations familiales, etc., constituent un tiers du revenu disponible des ménages ! Second pilier. La part de l’emploi public en France aujourd’hui est aussi forte qu’en 1982, grâce à la fonction publique territoriale qui a beaucoup recruté. Troisième pilier. Le droit du travail a été flexibilisé, mais il y a eu quand même des acquis sociaux : les 35 heures, la cinquième semaine de congés payés... Et surtout, le Code du travail régit toujours les relations entre employeurs et salariés : c’est tout de même 3 000 pages ! Là où le néolibéralisme a été le plus loin, c’est sur le quatrième pilier, celui de la politique économique. La finance a été libéralisée (politique industrielle), le libre-échange s’est imposé (politique commerciale), l’austérité salariale règne depuis trente ans (politique des revenus), les riches paient moins d’impôts (politique fiscale), et la monnaie a été placée sous la coupe de la finance (politique monétaire). Ici, énormément de terrain a été concédé. Mais la crise montre que le modèle néolibéral ne marche pas.
Fakir : Si l’on entend que « l’État ne peut plus rien faire », c’est, justement, parce que ce pilier a été délaissé ?
C. R. : Oui. Avec une nuance tout de même : seule l’Europe s’est privée à ce point de toutes ces politiques économiques. Aux États-Unis, par exemple, dès la fin du premier mandat de Reagan, on voit une politique d’intervention publique.

**[*« Ils ont gagné le fatalisme »*]
Fakir : Les acquis sociaux étaient, vous l’avez dit, avant tout des acquis sociaux nationaux, avec des différences selon chaque pays. Or, la remise en cause de l’État social s’effectue en même temps que celle des États-nations…
C. R. : La mondialisation a été l’argument majeur du libéralisme. Le fondement politique de l’État social, c’est la démocratie, celle-ci vit dans le cadre de l’État-nation. La citoyenneté n’est pas qu’un sentiment. Pour être citoyen, il faut vivre en République. Or, il n’y a pas de République mondiale ni européenne. Les libéraux, autour de la mondialisation, ont obtenu une véritable victoire intellectuelle. En inscrivant dans la tête que les décisions majeures se prennent à l’échelle du monde, ils ont gagné quelque chose de fantastique. Ils ont gagné le fatalisme, parce que le citoyen se sent complètement dépossédé, à l’échelle du monde il n’a pas de prise. C’est avec cette résignation des peuples, c’est-à-dire de la démocratie, que le capital peut imposer ses pleins pouvoirs.
Fakir : Mais alors, les politiques sont-elles vraiment menées dans un cadre international ? Ou nous le laisse-t-on seulement croire ?
C. R. : Les États-nations ont encore un rôle très important. Les États sociaux existent toujours dans des cadres nationaux, y compris en Europe. Les services publics, la protection sociale, le droit du travail sont essentiellement du ressort national. Il faut se départir de l’idée que les principales décisions se prennent à l’échelle du monde. Dans la crise, ce sont les états qui ont sauvé les banques, mis en œuvre les plans de relance. La notion de démondialisation est très importante.
Fakir : Et l’« Europe sociale », alors, comme avenir de l’état social ?
C. R. : Je le disais il y a un instant, la mondialisation a été l’argument majeur pour imposer le modèle néolibéral. Mais sur notre continent, nous avons eu droit à la double peine : la mondialisation et l’Europe. Les dirigeants, abusent toujours, même s’ils s’usent, de ces deux arguments pour dire au peuple : « Nous n’y pouvons rien, nous n’avons pas le choix. » Aujourd’hui, il faut éclaircir le débat sur l’Europe. L’Europe est un beau projet, qui pourrait apporter de belles choses sur les plans économiques et sociaux. Seulement, depuis l’Acte unique de 1986, qui a durci le libre-échange et organisé les privatisations, on va de régression sociale en régression sociale. Telle qu’elle existe, tout ce que touche l’Europe, elle le transforme en plomb. Toutes ses décisions sont empreintes d’un néolibéralisme dogmatique et radical. Il n’est plus temps, aujourd’hui, de se goberger avec une Europe sociale à venir. Il faut du concret, tout de suite : si l’Europe ne fait pas la preuve, concrètement, qu’elle peut être synonyme de progrès social pour les peuples, ces derniers vont se détourner et se détournent déjà – à juste titre – d’elle. Il faut entendre les cris : le « non » massif au Traité constitutionnel de 2005, les taux de participation aux élections européennes qui sont en chute continue, les dernières élections en Italie, le mot d’ordre dans les pays du Sud qui est « non à la Troïka », Troïka qui comporte deux institutions européennes [la Commission et la Banque centrale, auxquelles s’ajoute le Fonds monétaire international]. Au vu de cette réalité, et non de nos fantasmes, ou de nos espérances, qu’on cesse donc de sauter sur la chaise comme des cabris en promettant « l’Europe sociale, l’Europe sociale, l’Europe sociale ». L’Europe, même si elle était non libérale, n’est pas en mesure de remplacer les États sociaux nationaux.
**[*« Un souci avec la nation »*]
Fakir : Mais la nation, comme cadre, comme idée, ce n’est pas très « moderne » ?
C. R. : Voici un autre problème : une partie de la gauche a un souci avec la nation. Elle a, me semble-t-il, la même conception de la nation que le Front national, et comme elle n’aime pas le Front national… elle n’aime pas la nation. Elle réduit la nation à sa dimension culturelle : les origines, la langue, la culture. Cette gauche-là défend la cause nationale quand la nation est supposée opprimée. Mais une fois libérée, la nation deviendrait un objet nécessairement réactionnaire ! Certains ont le cerveau qui se contracte dès qu’ils entendent le mot « nation ». Pourtant, à la conception culturaliste et finalement raciste de la nation, il est possible d’opposer une autre conception : la nation comme communauté de responsabilités, objet citoyen et républicain. Le néolibéralisme n’a pas hésité à recycler certains arguments gauchistes pour asseoir son pouvoir : « À bas les règles ! À bas la nation ! À bas l’État ! » Il faut sortir de tout cela.

[( L’État social,
éditions Mille et une nuits, 2012)]
[/Propos recueillis par Antoine Dumini
et François Ruffin, relus et amendés
par Christophe Ramaux/]