Bals dans la peau
par 24/10/2007 paru dans le Fakir n°(33) Avril - Mai 2007
On a besoin de vous
Le journal fakir est un journal papier, en vente dans tous les bons kiosques près de chez vous. Il ne peut réaliser des reportages que parce qu’il est acheté ou parce qu’on y est abonné !
Qui s’en souvient, des petits bals du samedi soir, avec les remorques des cultivateurs comme estrades ? Qui s’en souvient, de cette Picardie des années 70, où les plus jeunes rêvaient d’une guitare électrique tandis que les anciens jouaient de l’accordéon ? Philippe Lacoche évoque ces années rock-Aisne-roll, et ses compagnons de musette se les remémorent avec lui.
« Je fis mon premier bal en mars 1972, à Montescourt-Lizerolles ; la salle des fêtes était bondée. Les danseurs s’étaient aspergés d’eau de toilette et de déodorant bon marché. L’orchestre s’appelait les Hans Eder. Paul, un chanteur au visage rond et rose, expulsait dans un micro Bouyer les refrains de la variété en vogue. Parfois, au détour d’une chanson, Rico délaissait son accordéon pour le remplacer. Les autres le laissaient parfois seul, "avec son musette". Je tentais de le soutenir en appuyant des accords métalliques sur ma guitare de fortune. La fumée de nos gauloises, qui se consumaient dans des cendriers en aluminium, nous piquait les yeux. Il faisait chaud dans la salle des fêtes de Montescourt-Lizerolles ; les autres musiciens croquaient à pleines dents dans les sandwiches au saucisson sec que leur avait apportés les membres du comité des fêtes, organisateurs de cette soirée. »
Dans son roman, Philippe Lacoche ne ressuscite pas que son copain Rico, mort trop jeune, trop seul, trop amer et on ne sait trop comment. C’est tout une époque qui revit avec lui, un temps où ces musiciens, « ouvriers dans une immense usine de cycles et de cyclomoteurs, à Saint-Quentin », ne comptaient « pas en jours, ni en semaines ou en mois, mais en bals ».
Le civet du dimanche
Des bals aux « cachets dérisoires » où « les remorques agricoles et boueuses des maires cultivateurs remplaçaient parfois les estrades ». Des bals où « provoqué par quelques malfrats de campagne », l’organiste ôtait sa chemise, bondissait dans la salle, se battait comme un chiffonnier et « remontait sur scène le nez défoncé, handicapé par une épistaxis, incapable d’aligner trois notes sur le clavier de son Hammond » tandis qu’une chaise s’écrasait sur le micro : « Mon Shure !, sanglotait le chanteur. C’est ma femme qui me l’avait acheté en vendant des produits de maquillage Avon. » Des bals d’où l’on revient si tard, à la nuit fraîche, avec « dans l’air de bonnes odeurs de foin coupé », troubadours et matériel entassés dans une 404 qui emprunte de « tortueux itinéraires avec l’espoir d’éblouir un lapereau » : « "Un lapin ! un lapin !" hurla Bernard. Il revint vers nous en courant ; le corps flasque et sanguinolent du garenne pendait au bout de son bras droit. Il jeta la bestiole dans le coffre ; en rentrant chez moi, je constatai que la bête s’était vidée sur l’étui écossais de ma guitare. » Des bals qui nourrissent leurs hommes : « Les lendemains de soirs de pleine lune, nous mangions souvent du civet. »
« C’était un gamin, le Phiphi ! Il a écrit des bouquins depuis, le bétail ! »
Au téléphone, Roland Flamant salue le parcours littéraire de son ancien guitariste. On le retrouve chez lui, dans l’Aisne, un pavillon au jardin verdoyant : « J’ai fait bâtir ma maison rien qu’avec des bals. Je touchais deux ou trois fois mon salaire des Impôts. » C’était un vrai boulot, il faut dire, « chef d’orchestre », à la fois agent artistique, manager, répétiteur, comptable : « Tous les ans, je présentais mes voeux aux mairies, avec mes tarifs sur du papier dactylographié. Je passais des semaines à faire du courrier, près de mille enveloppes... Et puis tous les jeudis soirs, on répétait dans le sous-sol. Avec cinq orchestres rien que sur Tergnier, il fallait tenir la route face à la concurrence. »
Des « canards » sans Mozart
C’est la seconde génération, lui : l’ère industrielle, presque, déjà. Elles sont passées, les heures bucoliques où Jacques Feuille, son accordéoniste, pédalait d’un bal à l’autre, vingt kilomètres avec son instrument sur un porte-bagage « spécial », muni d’« un sommier à ressort » : « A la Libération, y avait des bals partout, dans les rues, en plein air. Ils nous avaient privés pendant cinq ans, alors on se rattrapait ! Fallait voir les couacs et les canards qu’on faisait... c’était pas du Mozart ! Mais les gens ils ne l’entendaient point, ils dansaient, fins contents. Ca s’est gâté, après. »
Sous la pression des médias, dès les années soixante, le public se montre plus exigeant : « Quand un morceau passait à la radio, raconte Roland, fallait le jouer le samedi sinon on était lapidés ». Les formations se professionnalisent à demi : « J’avais investi dans un fourgon Ford, racheté un micro, une belle sono, des costumes, des jeux de lumière... » A cause des « musiques de la télévision », enfin, les modes s’accélèrent : « jerk, twist, madison » déferlent, « on n’arrivait plus à suivre ». L’ « Orchestre Reynaldo » (avec du tango au répertoire) est devenu « Roland Flamant et son orchestre » avant de muer en « The Strangers ».
« Phiphi et Dadac, ils jouaient, c’est pour le pognon, regrette un peu Roland. Notre musique, ça ne leur plaisait pas. » C’est vrai : arrive la troisième génération. Tandis qu’ils enchaînent, avec un brin de dédain, les tubes « de Claude François, de Mike Brandt, d’Herbert Léonard, d’Alain Barrière et de quelques autres (Bernard disait que nous faisions du ‘moderne’) », les plus jeunes, Philippe Lacoche et ses copains, rêvent à d’autres rythmiques, « aux envolées symphoniques de Van der Graaf Generator, aux mélodies de King Crimson, aux folies dadaïstes de Gong. »
Le titre du roman, d’ailleurs, le résume clairement : Des petits bals sans importance. Juste de la petite monnaie pour se payer une guitare électrique, « une vraie Gibson, une Lespaul comme celle de Jimmy Page », ou une mobylette Malagutti : « Rico m’avait désigné une petite motocyclette dont la puissance du moteur ne devait pas dépasser les 50 cm3. Le guidon était haut comme celui d’une Harley-Davidson. L’engin était équipé de sacoches qui se terminaient par de fines lanières de skaï noir qui imitaient le cuir. ‘Tu as vu les sacoches ! J’aime bien ; ça fait western.’ »
Morceaux de vie pilée
Des prestations alimentaires, rien de plus, ces soirées populaires : « Cinq heures d’affilée à aligner des rengaines de Frédéric François, se remémore "Dadac" – alias Gérard Lopez –, c’était démoralisant. Surtout après Woodstock, après des groupes progressifs comme Yes, ou Génésis, quand on était abonnés à Best, à Rock’n Folk, à Extra. Alors à côté, avec Philippe, moi à la basse lui à la guitare, on répétait avec des amplis dans un garage. On a enregistré un 45 tours avec notre groupe, "Purin", et on a tourné en Bretagne. » Trente ans plus tard, "Dadac" n’a rien renié de sa flamme d’alors : à Fargniers, près de Chauny, il initie les minots au jazz, au rock, au blues dans « les Caves à musiques – école de musiques modernes ». Derrière une vitre en plexiglas, un black ingénieur du son, avec un foulard rose fluo sur la tête, prépare un « mastering » sur son ordinateur : « On fait jouer les instruments séparément. Les groupes se préparent un an avant d’enregistrer, pour les professionnaliser au maximum. » Gérard Lopez se plaint, lui, que le studio résonne un peu, « mal insonorisé ». Un demi-siècle de technologie est passé.
« Tout s’est arrêté en 78-79, avec l’arrivée du disco. D’une année sur l’autre, les bals c’étaient fini. » Tandis que Roland Flamant évoque ce temps que les moins de cinquante ans ne peuvent pas connaître, son épouse redescend avec un accordéon : « C’était celui de son frère. Qu’est-ce qu’il jouait bien, ton frère ! Ca fait depuis son décès qu’on ne l’a pas bougé du grenier... » Ca l’émeut, bien sûr, Roland, cet objet remonté du passé. Un émoi qui ne trouble en rien Mireille : « Tenez, décoincez-le, Monsieur Feuille. Voir si on pourrait le donner à notre petit-fils... » Jacques enfile l’instrument, le presse contre son ventre : en sort le son d’un poumon asthmatique, ou bien tuberculeux. « Il est malade », diagnostique le musicien.
« A toi, Rico l’accordéoniste. » Voilà l’inscription sur sa tombe, au héros du roman. Avec dessous « une autre plaque, illustrée d’un dessin naïf gravé dans le marbre (il représentait un pêcheur qui tenait une gaule). » Et c’est grâce à ces Petits bals, à leur cacophonie nostalgique et ringarde, que le narrateur remonte « le flot contrariant des années qui fuient », jusqu’à ce refrain chantait à tue-tête : « Encore un carreau d’cassé, / V’là l’vitrier qui passe ! / Encore un carreau d’cassé, / V’là l’vitrier qu’est passé ». « J’entends encore leurs rires qui se mêlent et qui s’éloignent, s’éloignent, pour laisser place au silence infini et profond de ce qui n’est plus. Car la vie n’a rien d’une chanson ; il n’existe pas de vitrier pour recoller les morceaux des existences brisées. De Rico, mon copain musicien, et de Simon, mon cousin des champs, mon jeune homme seul de Reims, tous deux morts, il ne reste plus que des éclats de rire, des morceaux de vie pilée qui écorchent ma mémoire quand les accordéons rient les soirs de 14 juillet. »
(article publié dans Fakir N°33, mai 2007)


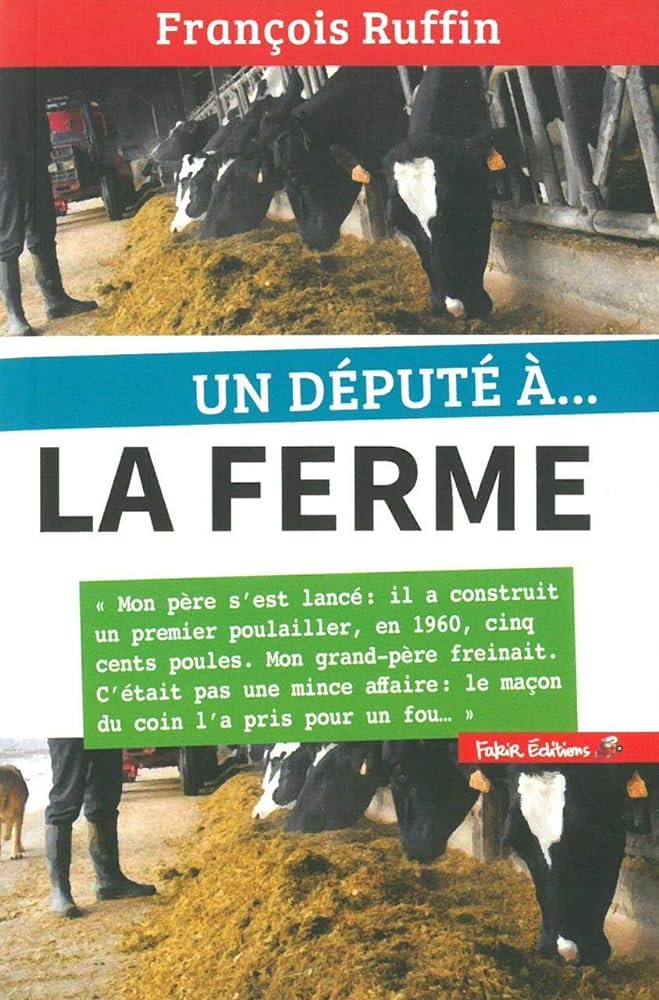





Messages
9 mars 2014, 22:04, par goutelle lionel
Et si on redonnait une seconde vie au slow comme genre progressiste de gauche ? Un bon slow d’à mort, ça s’insinue en vous à votre insu non ?...Alors pourquoi ne pas en profiter ?
http://www.dailymotion.com/video/x1fbyc5_la-maison-rose-version-slow_news